Entretien avec Nicolas Tenzer : « Lorsqu’on a devant soi un ennemi radical, il n’est d’autre choix réaliste que de le vaincre »
Notre guerre – Le crime et l’oubli : pour une pensée stratégique
Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po Paris, est non-resident senior fellow au Center for European Policy Analysis (CEPA). Il tient le blog de politique internationale Tenzer Strategics à la diffusion mondiale. Il est l’auteur de trois rapports officiels au gouvernement français et de vingt-trois ouvrages dont le dernier, consacré à la guerre russe contre l’Ukraine, Notre Guerre. Le crime et l’oubli : pour une pensée stratégique (Ed. de l’Observatoire, 2024) a obtenu le prix Nathalie Pasternak.

Six-cents pages. Trois parties. Une couverture sobre où le bleu ciel épouse le marine comme pour annoncer un éther sur le point de basculer dans l’orage. Notre Guerre s’impose d’emblée dans les rayons des librairies avec son titre taillé dans l’urgence du présent. La prose de Nicolas Tenzer tranche, net : limpidité éloquente, mais incisive. Pas de non-dits, d’euphémismes ou de minimisations ; chaque phrase vise droit, sans brouillard rhétorique. Si Notre Guerre offre une lecture fluide et agréable, c’est surtout son fond qui m’a conquise et impressionnée. L’ambition de l’ouvrage est d’être cet « appel à la lucidité » pour faire comprendre que « la guerre en Ukraine est la guerre décisive. » C’est réussi.
C’est réussi, d’abord, parce que l’élaboration de la pensée stratégique à suivre se révèle compréhensible du début à la fin. Les puissances démocratiques – en particulier celles du continent européen – doivent adopter une économie et une diplomatie de guerre afin de forger un discours et des objectifs communs à opposer à ceux de Vladimir Poutine, favoriser une coopération cohérente plutôt qu’une rivalité désorganisée dont Poutine tire profit, et ainsi condamner plus facilement les crimes du régime russe tout en faisant respecter le droit international. Cette stratégie, affranchie de tout relativisme, de toute naïveté et de tout silence, permet d’envisager la « défaite stratégique » de la Russie. Malheureusement, Nicolas Tenzer déplore à juste titre « l’absence de clarté dans les propos des dirigeants occidentaux », conséquence d’une alliance insuffisamment solide, d’une tolérance excessive à l’égard de la neutralité de certains États et du morcellement des sujets abordés lors des discussions, chaque partenaire privilégiant son agenda bilatéral au détriment d’un agenda commun.
Ensuite, c’est réussi parce que Nicolas Tenzer rappelle sans relâche qu’il faut s’en tenir au droit international, le mobiliser et le citer, car « il n’y a pas de paix sans respect du droit international et sans punition des crimes imprescriptibles ». L’ouvrage se distingue par sa capacité à signaler, sans redondance ni encombre, la nécessité de passer d’une conception hétéronormée – le droit international envisagé comme une contrainte extérieure – à une conception autonormée, c’est-à-dire une règle intériorisée. Pour ce faire, il insiste sur le fait que « les démocraties doivent se donner pour objectif de faire respecter le droit international (…) ce qui implique une compréhension stratégique de la violation du droit international », et qu’il est impératif d’éviter de « s’abriter derrière une prétendue impossibilité juridique, car la base légale existe. (…) C’est une question de volonté. » Une volonté qui permettra d’instaurer une Internationale de la liberté structurée et capable de toucher un large public – une lacune cruellement manifeste aujourd’hui, comme l’explique Nicolas Tenzer.
Enfin, c’est réussi parce que Nicolas Tenzer aborde, sans détours ni réserve, la question des crimes contre l’humanité. Il refuse de se perdre dans « le jeu avec les concepts » (Gilles Deleuze, cité dans Notre guerre) en affirmant que cette approche, qui évite d’examiner chaque réalité dans sa spécificité, conduit à une généralisation réductrice. La conséquence en est la déshumanisation, car « dans un univers de concepts, on n’a plus de comptes à rendre. » Ses propos résonnent dans un monde où la surmédiatisation et le détachement de la réalité par l’écran participent à la banalisation et à la normalisation des chiffres – qu’il s’agisse de victimes ou de crimes.
« Le chantier indispensable que doivent entreprendre les pays démocratiques dans les régimes dictatoriaux et tyranniques consiste à placer l’essentiel de leurs efforts du côté de l’action en faveur de la personne. Il est donc essentiel de parler de chaque personne singulière, de chaque visage, de chaque histoire, de chaque souffrance, afin de donner un visage aux anonymisés et de rendre compte du combat. »
L’entretien en intégralité
Je vous propose de débuter cet entretien par le commencement conventionnel : l’annexion de la Crimée en 2014 par la Russie. Vous expliquez qu’une intervention ferme des Alliés en 2013, face au massacre de la Ghouta en Syrie, aurait vraisemblablement dissuadé la Russie d’intervenir militairement en Ukraine en 2014. Peut-on dès lors considérer 2013 ou 2014 comme le véritable « point zéro », le moment charnière d’un nouvel ordre mondial ? Ou s’agit-il d’une lecture trop simplifiée de l’histoire ?
Nicolas Tenzer : Je pense effectivement qu’en termes d’analyse des effets portés à moyen et long termes, par le signal envoyé à la Russie de Poutine, 2013 constitue un véritable tournant. En effet, Barack Obama a montré, en n’appliquant pas les lignes rouges qu’il avait lui-même définies, que les pires crimes contre l’humanité pouvaient finalement être passés sous silence et, en tout cas, qu’un dictateur comme Bachar el-Assad pouvait continuer à commettre les pires atrocités en toute impunité. Les mois qui ont suivi les attaques contre la Ghouta ont également démontré que les Russes avaient les mains libres pour quasiment tout faire, puisque les Alliés — en particulier Obama — ont fait semblant de croire aux engagements russes, lesquels devaient veiller à la suppression des stocks d’armes chimiques du régime Assad. Ainsi, de ce point de vue, 2014 représentait la suite, marquée également par une inaction. Pourtant, il était encore temps de rattraper la situation en 2014. Je ne parle pas seulement de la Crimée, mais aussi du Donbass, car à ce moment-là, un certain nombre de dirigeants occidentaux — ainsi que des médias — avaient acheté le récit russe des soi-disant séparatistes du Donbass, alors qu’on savait pertinemment que ces derniers étaient totalement contrôlés et encadrés par l’armée et les services spéciaux russes. Là encore, nous sommes entrés dans une sorte d’univers de fiction, où l’on ne désignait pas clairement les faits. La situation s’est poursuivie en 2015 et 2016, lors du siège puis de la chute d’Alep : Obama n’a pas voulu entendre parler de la zone de non-survol que beaucoup réclamaient. Tout ceci constitue une accumulation de déficiences bien notées par Poutine. On peut remonter à la seconde guerre de Tchétchénie, où des protestations avaient surgi devant les massacres de civils commis par les armées de Poutine — massacres dénoncés à l’époque par Anna Politkovskaïa, Natalia Estemirova, puis par Boris Nemtsov notamment. On pourrait également évoquer 2008, en Géorgie, où 20 % du territoire géorgien furent saisis par les Russes. Quelle réaction ? Au début, George W. Bush, alors président, a montré les muscles en envoyant une flotte, ce qui a peut-être permis d’éviter que l’ensemble du territoire géorgien ne soit annexé par la Russie. Mais ensuite, on a complètement laissé faire. En 2009, Obama a même lancé le « reset » avec la Russie, et la coopération officielle entre l’OTAN et la Russie s’est poursuivie jusqu’en 2014. Ce n’est qu’alors aussi que l’UE a abandonné sa Russia Fort Policy. Il convient d’ajouter un fait très souvent passé sous silence : la guerre de 1992-1993 en Abkhazie. À cette époque, les Russes ont aidé les soi-disant indépendantistes à commettre un véritable nettoyage ethnique, entraînant des milliers de victimes géorgiennes. Il faut mettre fin à ce cycle de complaisance qui a détricoté notre sécurité. Il faut vaincre la Russie en Ukraine pour y mettre fin. Cette forme d’inaction qui remonte à très loin.
Vous affirmez que l’Organisation des Nations unies (ONU) est devenue obsolète face aux guerres majeures initiées par l’un de ses membres permanents. Peut-on aller encore plus loin et dire qu’elle est désormais totalement inutile, notamment sous le second mandat de Donald Trump, marqué par le désengagement des États-Unis des organisations internationales et par des menaces de retrait de l’OTAN ? Certains évoquent la notion de ‘Westlessness’ lors de la Conférence de sécurité de Munich ; vous-même parlez de la mort du transatlantisme. L’ONU peut-elle encore jouer un rôle dans la résolution de cette guerre ?
Je vais être assez clair là-dessus : dans cette guerre, l’ONU ne peut jouer absolument aucun rôle. Ma réponse est catégorique et nette, d’autant plus que l’on assiste à un passage du « 2 + 3 » au « 3 + 2 » au Conseil de sécurité des Nations unies. Je ne dirais pas que l’ONU est devenue complètement obsolète en tant que telle, car elle regroupe une série d’organisations — que ce soit le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) —, des agences qui restent utiles, sans oublier l’Assemblée générale des Nations unies, où l’on adopte des résolutions, y compris celles ayant permis de condamner très clairement l’agression russe. Un très joli proverbe sahélien dit : « Mieux vaut un arbre à palabres que pas d’arbre du tout. » Cela correspond assez bien à la fonction de l’ONU. Aujourd’hui néanmoins, l’ONU — enfin, l’organisme central qu’est le Conseil de sécurité — est totalement irréformable. De nombreuses propositions ont été mises sur la table, notamment une proposition de la France demandant qu’il n’y ait pas de possibilité de veto lorsqu’il y a eu crimes de masse. Or, ces propositions n’ont strictement aucune chance d’aboutir.
En conséquence, la résolution de la guerre en Ukraine devra-t-elle nécessairement passer par un accord ou une série d’accords bilatéraux ? Je pense notamment aux négociations initiées sous la présidence de Donald Trump entre la Russie et les États-Unis, qui excluaient non seulement l’Europe, mais aussi l’Ukraine.
Aujourd’hui, je me refuse de parler d’accord à propos de l’Ukraine. Je suis très clair là-dessus. Je fais partie de ceux qui disent : « N’employons pas le terme de négociation avec la Russie ». Je l’ai écrit déjà dans un article de 2016 intitulé « Pourquoi il ne faut pas négocier avec la Russie de Poutine ». Toute forme de soi-disant accord de paix, quels qu’en soient les initiateurs, serait un accord qui préparerait la guerre future. Donc, tant que la Russie n’est pas vaincue — scénario envisageable quand on observe l’état de l’économie et de l’armée russes —, cela impliquera que les Européens, mais aussi le Canada, le Japon, la Corée du Sud et l’Australie — puisque, aujourd’hui, on ne peut plus compter sur les Américains —, ont tout intérêt à s’unir sur des sujets majeurs, comme l’Ukraine aujourd’hui, Taïwan demain, afin de faire face aux alliances des trois grandes puissances révisionnistes.
Vous plaidez pour une diplomatie de guerre : une diplomatie globale qui assume que ‘nous sommes en guerre’, en définissant des objectifs stratégiques, en mobilisant des outils de coercition et en adoptant une diplomatie d’action plutôt que de simples déclarations. Emmanuel Macron a récemment appelé à une mobilisation et un effort collectifs, évoquant même l’envoi de troupes non belligérantes en Ukraine une fois la paix établie. Voyez-vous là les premiers signes de cette diplomatie de guerre ? D’autant plus que Mark Rutte, Secrétaire général de l’OTAN, a récemment plaidé pour une augmentation des dépenses militaires des États membres, visant un objectif de 3 % du PIB.
La première chose, si l’on en croit Mark Rutte, consiste à se préparer à la guerre. Il n’est pas le seul à le dire. Emmanuel Macron l’évoque à mi-mot, mais assez clairement, notamment dans son dernier chat avec les internautes. Le Polonais Donald Tusk, ainsi que les Britanniques, les Danois, les Baltes l’affirment depuis bien plus longtemps. Aujourd’hui, nous devons absolument passer à un autre rythme de dépense, tant en volume qu’en cadence. Volume, car il faut atteindre sans doute les 4 % voire 5 % du PIB ; et rythme, parce qu’il va falloir accélérer. Ce n’est pas un objectif à atteindre dans 15 ans, mais dans 2 ou 3 ans. Cela suppose de passer en économie de guerre. Je me rappelle les déclarations d’Emmanuel Macron en juin 2022, lorsqu’il affirmait que l’Union européenne devait le faire. Personne ne s’y est encore employé au sein de l’UE. Il est plus que temps. Passer en économie de guerre suppose une mobilisation des entreprises nationales et une répression plus efficace de tous les agents étrangers en France et en Europe — ceux qui véhiculent des messages de propagande russe et qui sont payés pour le faire. Deuxièmement, concernant l’envoi de troupes cela aurait dû se faire dès le 24 février 2022. Je l’ai affirmé sur plusieurs chaînes de télévision à l’époque : il fallait intervenir directement, non pas en envoyant des hommes sur le terrain, mais en déployant des dispositifs embarqués dans des avions, des missiles tirés depuis la flotte, et d’autres systèmes visant les forces russes présentes en Ukraine. Nous aurions pu aussi envoyer des troupes bien plus rapidement, ne serait-ce que pour protéger les populations ukrainiennes. En effet, les Russes n’auraient pas osé tirer sur des troupes d’un certain nombre de pays de l’OTAN si elles avaient été présentes pour protéger les Ukrainiens. Cela aurait constitué un élément de dissuasion. Enfin, la proposition nouvelle évoquée par Emmanuel Macron et d’autres européens consiste à dire que, s’il y a un accord de paix, il faudrait envoyer des troupes en Ukraine. J’y suis, bien sûr, favorable, mais si j’aurais préféré l’envoi de troupes pendant la période chaude de la guerre. Mais il ne faudrait pas que cela conduise à passer par pertes et profits tous les territoires ukrainiens occupés par les Russes — des territoires où l’on assiste à des exécutions sommaires, des actes de torture, des viols collectifs et des déportations d’enfants. Si l’on acceptait cet état de fait, Zelensky semble parfois y consentir parce qu’il est poussé à tenir ce discours accommodant, ce qui signifierait que nous donnons à Poutine — nous, Occidentaux — l’autorisation de tuer, de torturer, déporter, de violer. C’est absolument inacceptable. Faisons donc attention à ce que cet accord de paix ne devienne pas un fait accompli, et surtout, continuons à armer l’Ukraine jusqu’aux dents !
Pensez-vous que cette diplomatie de guerre serait plus efficace et plus simple à instaurer si l’élan venait d’en bas ? Dans Notre guerre, vous opposez une Europe de l’Ouest installée dans le confort d’une liberté acquise de longue date à une Europe de l’Est plus lucide face au risque de la perdre. Si cette prise de conscience était plus forte au sein des sociétés occidentales, les dirigeants seraient-ils moins timides dans leurs discours et la transition vers une économie de guerre, un effort de guerre intensif ?
Vous soulignez à juste titre une distinction entre une partie de l’Europe centrale et orientale et l’Europe de l’Ouest – l’Allemagne, la France, mais aussi l’Italie, l’Espagne, le Portugal, etc. Il est vrai qu’il existe une perception différente du danger russe. Certes, cette perception s’est accrue ces derniers temps, ce qui est une bonne chose, mais il reste encore du chemin à parcourir. Là où votre point est essentiel, c’est qu’une diplomatie de guerre et l’adhésion des peuples d’Europe de l’Ouest à l’effort de guerre, qui implique des sacrifices, nécessitent d’en parler ouvertement. C’est une suggestion que j’ai faite depuis longtemps aux autorités françaises : il faut évoquer quotidiennement le risque russe. Il faut rappeler sans cesse les crimes de masse commis par la Russie en Ukraine et ceux qu’elle a commis ailleurs par le passé. Ce discours commence à émerger, mais trop tardivement. Je me souviens encore de responsables politiques affirmant : « Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. » Je comprends qu’ils ne puissent pas dire « Nous sommes en guerre avec la Russie. », car ce serait une déclaration lourde de conséquences. Cependant, ils n’auraient pas dû affirmer le contraire, car, de fait, la Russie nous fait la guerre. Certes, personne n’imagine voir des chars russes défiler sur les Champs-Élysées, mais si l’Ukraine tombe, les risques pour notre sécurité vont s’accroître à moyen terme. Les services de renseignement de plusieurs États ont déjà mis en évidence des attentats terroristes planifiés – certains ont échoué de justesse. Nous avons observé des sabotages, des incendies volontaires dans plusieurs pays et même des attentats qui ont failli faire exploser des avions en plein vol. Tout cela ne fera que s’intensifier. Nous avons donc un besoin urgent que les dirigeants d’Europe de l’Ouest parlent plus clairement de cette menace, donnent des exemples concrets et désignent les choses par leur nom.
Dans votre livre, le message est clair : Vladimir Poutine mène une guerre totale, une guerre d’extermination et de destruction, opposant la mort et le nihilisme au droit international et à l’ordre humain. Dans ce contexte, les déclarations de Donald Trump qualifiant Volodymyr Zelensky de « dictateur sans élections » et l’accusant d’être responsable de la guerre en Ukraine en disent long. Un pays allié pourrait-il, en adoptant le discours de Poutine, basculer dans le camp de la destruction et fournir les éléments décisifs à une victoire russe ?
Oui. Aujourd’hui, nous observons un événement sans précédent côté américain : un renversement d’alliance. Les États-Unis sont passés de l’autre côté du miroir. Pour combien de temps ? Je n’en sais rien. Est-ce que cela cessera après la présidence de Trump ? Fera-t-il même, au mépris de la Constitution, trois ou quatre mandats ? Je ne le sais pas non plus. Il est assez âgé, mais tout est possible. Mugabe et Mahathir sont restés au pouvoir jusqu’à 93 et 95 ans. Qui lui succédera ? Trump est en train de détruire les institutions civiles américaines. Les risques d’un point de non-retour sont élevés. Les États-Unis se sont allié à nos ennemis. Cela concerne Poutine, mais pas seulement. Ils pourraient aussi se rapprocher de la Chine. Contrairement à ce que l’on dit souvent – à savoir que Trump voudrait en finir avec cette guerre pour s’affronter à la Chine –, je pense que la connivence avec Pékin existe. Trump se place du côté des grandes puissances et méprise totalement le droit international, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes… et le droit tout court. On ne devrait même pas préciser « international », car aux États-Unis aussi, il entend s’affranchir de la règle de droit. Chez lui, il n’y a plus de distinction entre l’agresseur et l’agressé, entre la victime et le coupable, entre le juste et l’injuste. Il bouleverse tous nos repères et principes. C’est extrêmement grave. J’ai beaucoup reproché à Obama et Biden leur inaction, mais on ne pouvait pas dire que l’Amérique d’Obama ou de Biden n’était pas notre alliée. Elle le restait malgré tout, car leurs principes et règles demeuraient les nôtres. Avec Trump, c’est complètement différent. Un autre élément caractéristique de Trump, c’est son mépris total pour la vérité. Est-on dans la post-vérité (post-truth), la contre-vérité, l’anti-vérité ? Difficile à dire. Quand il affirme que « Zelensky est un dictateur », il suffit de regarder le nombre de présidents ukrainiens élus depuis que Poutine est au pouvoir : il y en eut cinq. Quand il prétend que Zelensky ne bénéficierait plus que de 4 % d’opinions favorables alors qu’il en recueille plus de 60 %, ou lorsqu’il affirme que c’est l’Ukraine qui a déclenché la guerre, il se situe dans un univers parallèle. Mais pour Trump, les faits n’ont plus d’importance. C’est pourquoi, aujourd’hui, les États-Unis ne sont plus notre allié. Comme je l’écrivais dans l’un de mes derniers articles, le lien transatlantique est désormais complètement brisé.
Que devrait faire alors l’Europe ? L’ancien ministre des Affaires étrangères slovaque, Ivan Korčok, avait par exemple, proposé de coopérer davantage avec la Chine pour isoler totalement Trump et lui montrer que l’Europe pouvait se tourner vers son ennemi, comme lui s’est tourné vers le nôtre. Est-ce une position extrême ?
Non, cela me paraît totalement fantaisiste. J’ai entendu deux discours successifs, venant de différents décideurs et analystes. Certains disaient il y a encore quelques années : « Il faut s’allier à la Russie pour contrer la Chine. » Depuis 2022, la tendance s’est inversée et certains affirment : « Il faut s’allier à la Chine pour contrer la Russie. » Cela relève exactement de la même incompétence dans l’analyse stratégique. On sait que la Chine soutient la Russie dans cette guerre. Avec Xi Jinping – qui, en cela, est très différent de Jiang Zemin et de Hu Jintao, ses prédécesseurs –, nous avons un dirigeant qui veut renverser l’ordre international. Il existe donc une forme d’accord, ou du moins une conjonction idéologique, entre Moscou, Pékin et Washington aujourd’hui. Donc, s’allier à la Chine, sans parler de tous les crimes commis par ce pays, ni des menaces qu’elle fait peser sur Taïwan, me paraît effectivement être une idée complètement simpliste et totalement dépassée.
Lorsque vous écriviez ce livre, Bachar el-Assad était toujours au pouvoir. Or, le 8 décembre 2024, l’organisation Hayat Tahrir al-Cham (HTC) a accompli l’invraisemblable en provoquant la chute de son régime. Dans votre ouvrage, vous soulignez à plusieurs reprises l’échec des Alliés à empêcher les massacres en Syrie, pointant leur « patience stratégique » (Barack Obama) et un positionnement « pseudo-réaliste » (Raymond Aron). Aujourd’hui, quel est votre point de vue sur ce qui s’est passé ? Comment cela va-t-il impacter la guerre en Ukraine, mais aussi l’ordre international ? Êtes-vous favorable à une intervention des puissances occidentales pour reconstruire le pays ou, au contraire, plaidez-vous pour une abstention totale de leur part ?
D’abord, cette révolution syrienne était quelque chose d’extraordinaire. Le peuple syrien s’est libéré par lui-même, avec l’aide de personne. Certains disent : « Oui, mais c’est la Turquie qui a tout fait. » Non. La Turquie a donné son accord, probablement, mais ce n’est pas elle qui a libéré la Syrie : les gens de HTC l’ont fait avec d’autres, y compris des personnes qui n’étaient pas islamistes ni même musulmanes, mais aussi parfois chrétiennes ou athées. Je me souviens de discussions post-2011 et de débats parfois vifs : j’étais de ceux qui affirmaient, comme plusieurs Syriens que je connaissais, « la révolution n’est pas terminée, et la guerre n’est pas finie », alors que certains prétendaient : « C’est terminé, la guerre est finie, il faut renouer avec Assad. C’est malheureux, mais il faut faire avec. Le réalisme nous oblige ». Certains avaient d’ailleurs été pour le moins complaisants envers ce régime… Je leur répondais : « Non, la guerre n’est pas finie, ni la révolution. » Je n’imaginais pas ce qui s’est passé. Je ne vais pas prétendre que j’avais prévu un dénouement aussi rapide, personne ne l’avait prévu. Mais je constatais tout de même qu’il restait, en Syrie, avant la chute d’Assad, de nombreux mouvements de protestation qui continuaient de se développer. Donc je pensais que, un jour ou l’autre, il serait renversé. Voilà pour le premier point. Deuxièmement, je pense qu’aujourd’hui, après quelques hésitations, les Alliés doivent réellement renouer avec ce nouveau régime et aider le peuple syrien à s’en sortir, car Assad a laissé, au-delà d’un million de victimes, une pauvreté colossale. Il faut reconstruire le pays, rémunérer les fonctionnaires pour éviter qu’ils ne retombent dans l’escarcelle des groupes mafieux susceptibles de reprendre le contrôle. Il y a un besoin de stabilité économique et financière et de planification de la reconstruction. Certains objecteront qu’il faut être vigilant vis-à-vis de HTC, compte tenu de ses antécédents. Certes, je ne prétends pas que ce soient des saints ni qu’il n’y ait aucun risque. Mais jusqu’à présent, les mesures de vengeance sont restées limitées. Les bavures sont restées relativement limitées. On n’a pas observé d’actions majeures de HTC contre les anciens opposants, ni de nouveaux massacres. Donc, il faut être vigilant sur un certain nombre de sujets : les droits fondamentaux, le respect de l’opposition, le droit des femmes, et la garantie de toutes les libertés fondamentales. Cependant, selon de bons spécialistes de la Syrie, l’ancien chef djihadiste, Ahmed al-Sharaa, s’est converti en un leader nettement plus responsable. Par le passé, certes, des membres de HTC ont commis des crimes. A l’origine, ils étaient affiliés à Al-Qaïda, chose qu’on ne peut pas nier. Toutefois, ce ne sont ni les talibans, ni le régime iranien, ni l’État islamique. En conséquence, il faut réellement aider la Syrie à s’en sortir, ce qui suppose un réengagement clair avec ce pays. N’importons pas non plus en Syrie les schémas issus de nos débats nationaux.
Une phrase de votre livre m’a particulièrement marquée : « L’absence de noms conduit à l’oubli des crimes ; les victimes sont anonymisées et déshumanisées » (p.169). En écho au sous-titre de votre livre « Le crime et l’oubli, » peut-on dire que le véritable « crime » de l’Europe et de ses dirigeants est l’oubli ? L’oubli du droit international humanitaire, des Ukrainiens, ou encore du mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) contre Vladimir Poutine ?
Tel est le risque. Gardons une position totalement ferme : il n’y a pas de discussion possible avec Poutine, on ne le rencontre pas, on ne le tutoie pas, on ne lui serre pas la main. Ce sont des règles fondamentales. Nous devons rappeler et dénoncer ses crimes en permanence. La plupart des dirigeants des pays démocratiques et libéraux ne le font pas assez. Si j’avais été président de la République française ou Premier ministre d’un autre pays européen, je parlerais presque quotidiennement des crimes commis. Il ne faut ni les oublier ni les pardonner. Ces crimes, comme je l’évoque dans mon livre, touchent directement à nos intérêts – ce que l’on appelle les intérêts nationaux. Or, ces intérêts ne se limitent pas aux aspects stratégiques ou économiques ; ils englobent aussi nos principes et nos valeurs, comme le rappelait Raymond Aron. Cela fait partie de notre identité démocratique. Oublier l’héritage de Nuremberg constituerait une forme de crime européen. Deuxième point : le crime est le message, pour paraphraser Marshall McLuhan. Lorsqu’un régime commet des crimes d’une telle ampleur, avec une massivité et une continuité frappantes, il ne s’agit pas simplement d’exactions isolées. Oui, d’autres puissances, y compris occidentales, ont aussi commis des crimes : les États-Unis au Vietnam et en Irak – on pense à la prison d’Abou Ghraib où des tortures ont été appliquées… Ce n’est pas excusable, mais ce n’est pas non plus équivalent. Ici, nous avons affaire à une logique du crime pour le crime, perpétuée depuis des années, dans plusieurs pays, par la Russie. Cela révèle une volonté de démanteler non seulement l’ordre juridique, mais aussi l’ordre humain international, de rayer des populations entières de la carte. Si nous décidons demain d’effacer tout cela, ce ne serait pas seulement une trahison des victimes ; ce serait aussi une trahison de nos principes et de nos propres règles de sécurité.
Vous établissez une comparaison entre Adolf Hitler et Vladimir Poutine et affirmez qu’une paix avec ce dernier « Would erase Nuremberg ». Que répondez-vous à ceux qui s’indignent face à une telle analogie, la rejetant comme excessive, voire calomnieuse ?
Tout simplement, en rappelant deux choses. Premièrement, il y a un caractère unique de la Shoah, par son immensité et sa spécificité. Chaque génocide possède d’ailleurs une singularité propre, que ce soit le génocide arménien, la Shoah, le génocide des Tutsis au Rwanda. Chaque tragédie de l’Histoire est marquée par ses propres circonstances. Cependant, lorsque vous avez un homme qui détruit sciemment, assassine délibérément des milliers — ou plutôt des dizaines de milliers — d’enfants, de femmes, d’hommes, de civils ; qui cherche systématiquement à annihiler tout un peuple ; qui déporte des enfants pour les assimiler à sa propre communauté, ce qui est, selon la Convention du 9 décembre 1948, un crime de génocide, alors vous pouvez comparer. Il existe ce que j’appelle « un fil de l’histoire », un lien qui traverse ces différentes périodes. Bien sûr, Poutine n’est pas Hitler. Il ne l’est pas, car il n’a pas commis la Shoah, car les circonstances sont différentes et car son idéologie n’est pas identique, même s’il reprend des éléments du nazisme. On ne peut ignorer qu’il s’inspire d’Ivan Ilyine, un penseur nazi russe mort en 1954, qu’il a réhabilité en rapatriant ses cendres en Russie en 2005. Il existe donc des références idéologiques au nazisme dans la pensée de Poutine, et cela ne doit jamais être sous-estimé. Mais si l’on martèle que « Poutine n’est pas Hitler », on risque implicitement de minimiser ses crimes. Derrière cette affirmation, il y a une forme d’indulgence accordée à Poutine. Dire « Poutine n’est pas Hitler » revient, d’une certaine manière, à diluer la gravité de ses actes. Ainsi, à travers cette idée de continuité historique, on peut établir un lien entre les crimes de masse perpétrés à différentes époques. Je pourrais citer d’autres exemples, comme les crimes contre l’humanité perpétrés par Milošević et ses affidés. Peu importe les chiffres : il est indécent de remarquer qu’il n’y a pas eu 6 ou 10 millions d’Ukrainiens tués, mais si Poutine en avait eu la possibilité, il aurait sans doute commis un massacre d’une ampleur similaire à celle perpétré par Hitler. En Ukraine, nous parlons de centaines de milliers de morts. C’est bien plus que Srebrenica, qu’Oradour-sur-Glane, bien plus même que Babyn Yar. Toutefois, il ne s’agit pas de comparer les crimes en les quantifiant froidement. Entrer dans une logique de comptage n’a pas de sens. Ce qui compte, c’est la similitude des mécanismes à l’œuvre. Et c’est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de dire simplement : « Poutine n’est pas Hitler ».
Une autre phrase de votre livre m’a frappée : « Être émotif, c’est l’expression de nos valeurs, l’émotion prend appui sur des faits réels » (p.230). Le langage émotif, est-ce la stratégie pour unir une Europe minée par le chacun pour soi, le silence et l’absence d’un langage commun face à Poutine ? Cela passe-t-il par la suppression des euphémismes comme « négociation », « dialogue », ou « escalade » ?
Ma réponse est dans votre question. Je pense effectivement qu’il y a des termes qu’il faudrait bannir depuis longtemps, comme ceux que vous avez évoqués, notamment « escalade ». Dans la sensibilisation de l’opinion publique à la réalité de la guerre et dans la préparation à l’effort de guerre, il faut parler de tous les crimes commis. Il faut donner droit à l’émotion, car, encore une fois, l’émotion est aussi l’expression de nos principes et de nos valeurs. Ce qui tient une société ensemble, ce pour quoi nous nous battons, ce que nous voulons défendre, est lié à nos émotions partagées. Le fait qu’une communauté donnée ressente une même indignation et horreur devant le crime est essentiel. D’une certaine manière, c’est ce qu’Émile Durkheim appliquait déjà, à la fin du siècle précédent, à l’ordre interne d’une société lorsqu’il évoquait les crimes de droit commun. La conscience commune passe par une émotion commune. Sur un plan géo-stratégique, si l’on se ferme aux émotions, on ne comprend pas pleinement la réalité d’un régime qui commet de tels crimes abominables. Si les dirigeants occidentaux avaient été plus sensibles aux crimes commis par Poutine depuis 25 ans, ils ne seraient pas allés – comme je l’évoque dans mon livre – assister à la Coupe du monde de football en 2018 en Russie. À cette époque déjà, les crimes contre les Ukrainiens, les Syriens, les Géorgiens, les Tchétchènes, et tant d’autres, étaient massifs. Pourtant, ils ont été complètement oubliés et passés sous silence. L’émotion n’est pas seulement l’expression d’une communauté : elle permet aussi de mieux percevoir les risques géostratégiques. C’est donc un enseignement stratégique, et pas seulement moral ou sensible. C’est enfin un enseignement intellectuel et cognitif.
Avec Notre guerre, quel message souhaitez-vous adresser aux dirigeants du monde, aux Européens et aux Ukrainiens ? Si chacun de ces trois publics ne devait retenir qu’une seule idée de votre ouvrage, laquelle serait-elle ?
Un seul message ? J’allais dire : ne cédez jamais, ne renoncez jamais, ne transigez pas avec le mal. Je ne veux pas reprendre la phrase de Jean-Paul II, « N’ayez pas peur », mais elle reste importante dans ce contexte. Si vous commencez aujourd’hui à céder, c’est vous qui serez les prochains sur la liste. On peut rappeler la fameuse formule du pasteur luthérien Martin Niemöller – vous la connaissez probablement : « Quand ils sont venus chercher les socialistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas socialiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les Juifs, je n’ai rien dit, je n’étais pas juif. Puis, ils sont venus me chercher. Et il ne restait personne pour protester. » C’est une phrase très connue, certes, mais loin d’être une banalité. Elle reste d’une profondeur fondamentale. Les occidentaux ne sont pas venus pour les Tchétchènes, pour les Géorgiens, pour les Syriens, pour les Ukrainiens, pour les Africains, eux aussi massacrés par la milice Wagner, et il n’est désormais personne pour les défendre. Donc, résister, oser, ne jamais céder : voilà, je pense, la leçon essentielle à retenir. À un moment où l’on parle – comme ces jours-ci – de prétendus accords de paix, je dis : Attendez ! Ces accords de paix en trompe-l’œil sont déjà une forme de capitulation. C’est pour cela que je refuse ce terme. Lorsque l’on a devant soi un ennemi radical, il n’est d’autre choix réaliste, c’est-à-dire conforme à nos intérêts de sécurité, que de le vaincre. Et là, nous sommes devant cet ennemi radical. Je me rappelle ce que ma mère me disait après son expérience de déportation par les nazis et de résistance : « Nous avions une certitude, mes compagnes et moi : nous combattions le mal radical. » Aujourd’hui, avec la Russie de Poutine, nous sommes devant un nouveau visage de celui-ci.
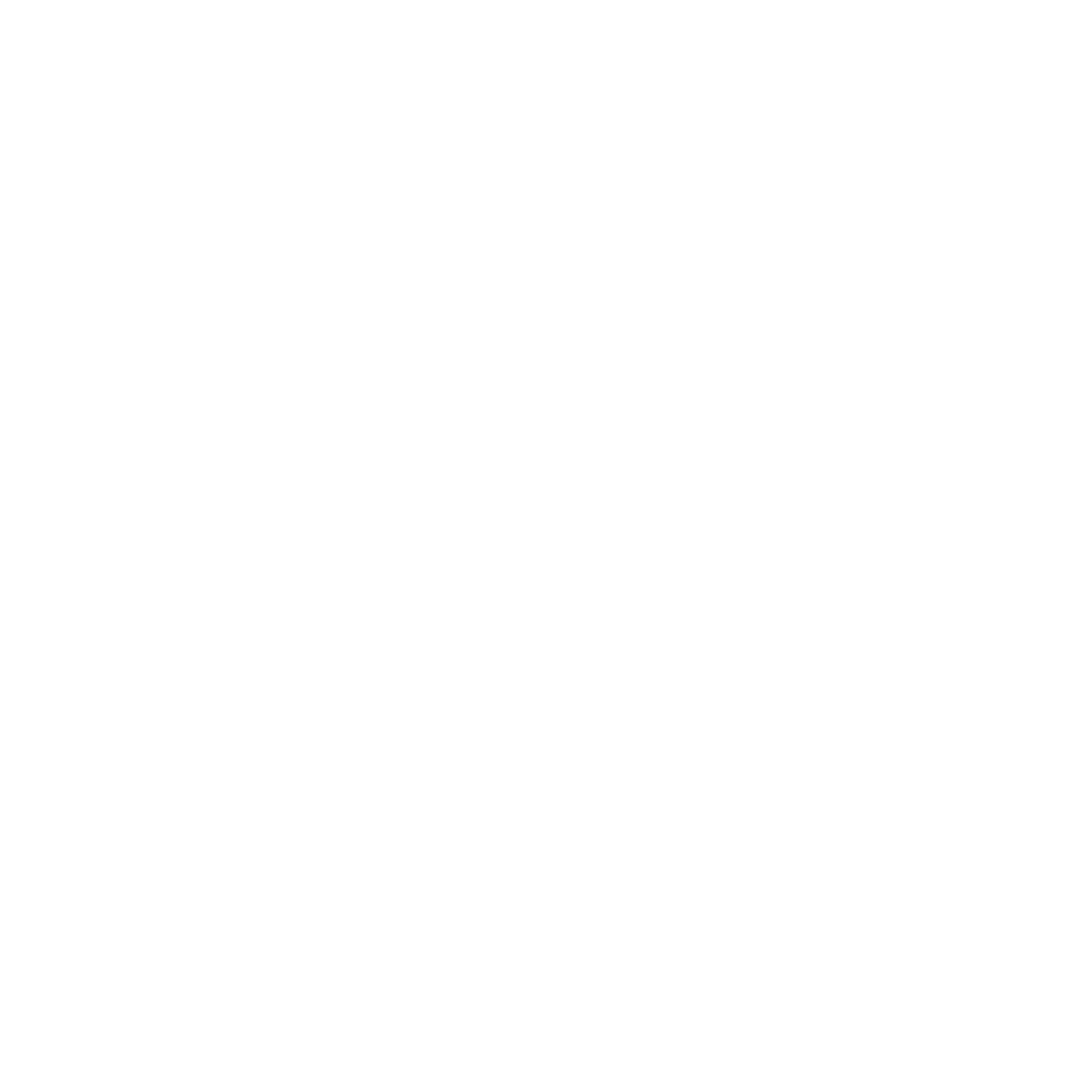
Laisser un commentaire