« The Walnut Tree » de Kate Morgan : les droits des femmes face aux lois britanniques, quel héritage international?
Women, Violence and the Law : A Hidden History
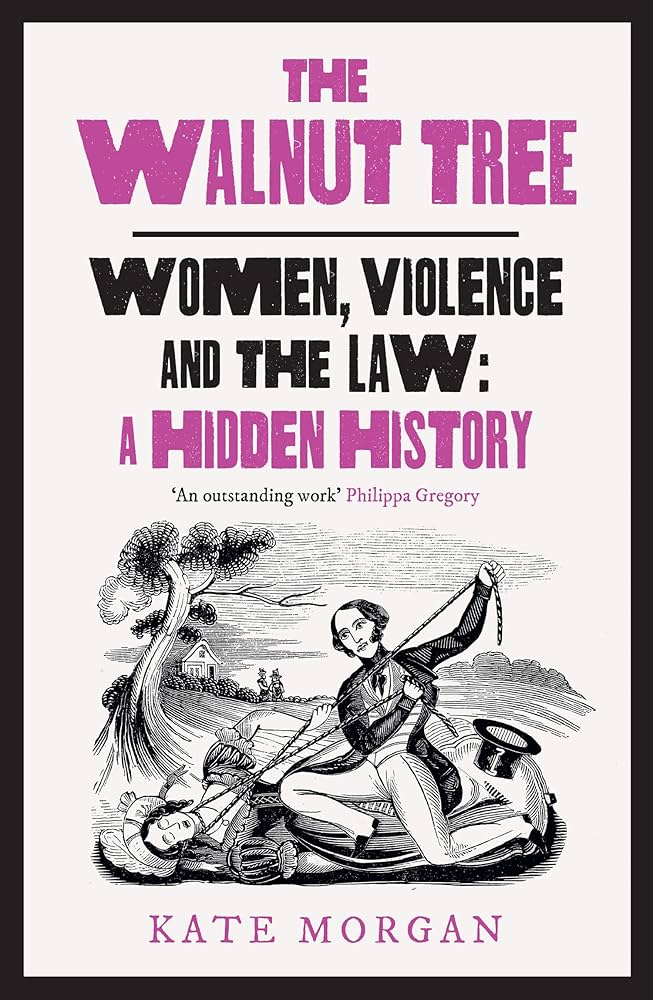
Après avoir contemplé ses façades géorgiennes, foulé ses pavés où résonnent encore les bottes de Dickens et arpenté ses rues bruissantes des sifflets des suffragettes, mon année d’échange universitaire à Londres touche désormais à sa fin. J’ai estimé que pour parachever ce séjour londonien, je ne pouvais mieux choisir que d’écrire sur Le Noyer (The Walnut Tree) de Kate Morgan. Sa couverture audacieuse aux teintes rose fluo et noir épais est à l’image de son contenu : le traitement réservé aux femmes par la législation britannique durant les ères victorienne et édouardienne. Comment le pays de l’Habeas Corpus et de la Magna Carta a façonné nos conceptions contemporaines sur des questions aussi cruciales que les violences domestiques, les agressions sexuelles et le divorce ? Dans l’ombre du noyer, Kate Morgan nous rappelle que si les droits des femmes relèvent d’une histoire récente, leur combat, lui, puise ses racines dans des siècles de résistance.
« Depuis des temps immémoriaux, les changements dans les lois des nations ont été provoqués par des exemples individuels d’oppression. Ces exemples ne peuvent être sans importance, car ils sont, et seront toujours, les petites charnières sur lesquelles les grandes portes de la justice s’ouvrent. » – Caroline Norton dans The Walnut Tree (p.11)
Au fil de son analyse, Kate Morgan associe avec brio des cas individuels, en apparence anodins, de femmes subissant des violations de leurs droits et la législation britannique afférente. Ce format permet de se placer dans le contexte historique du Londres du XIXᵉ siècle et de constater, avec une profonde déception, que les avancées obtenues en matière de droits des femmes ne seraient que partiellement satisfaire Emmeline Pankhurst, Caroline Norton ou Josephine Butler. En effet, l’essor des mouvements féministes et l’attention croissante portée aux droits des femmes dans les sphères médiatique, politique, économique et académique, créent l’illusion d’une cause acquise. Pourtant, dans l’ombre des apparentes victoires juridiques, la réalité est autre. Aujourd’hui encore, des femmes à titre individuel subissent les mêmes violences et injustices que celles endurées, il y a deux siècles, par Emily Jackson, Mabel Russell, Jenny Percy, Elizabeth Cass ou Ruth Haley. Car même si les droits des femmes sont désormais largement reconnus et protégés, deux constats s’imposent : d’une part, cette reconnaissance est plus récente qu’on l’imagine et semble déjà menacée par l’érosion des droits sexuels et reproductifs, la montée des idéologies misogynes et extrémistes (sphères masculinistes, trumpisme), les régimes liberticides (Iran, Afghanistan) et les violences de genre dans les conflits ; d’autre part, la consécration des droits des femmes demeure imparfaite si leur application effective n’est pas garantie au universellement et au quotidien. Comme le rappelle la Ligue des droits de l’Homme : « Nulle part les droits des femmes ne sont définitivement acquis : en Europe, les femmes voient le droit à la maîtrise de leur corps remis en cause par des forces conservatrices. Ailleurs, des femmes luttent encore pour des droits fondamentaux comme le respect de l’intégrité de leur corps, de leurs choix matrimoniaux, comme l’accès à l’emploi, à des droits familiaux qui ne les réduisent pas à l’état de mineures, à l’égalité dans l’héritage etc. »
Mariage
Au XIXᵉ siècle, la condition juridique de la femme anglaise était déterminée par son passage du statut de feme sole (femme célibataire avec des droits) à celui de feme covert (mariée), devenant « propriété légale de son mari sous forme humaine. » L’existence et l’identité juridiques d’une femme mariée étaient complètement absorbées par celles de son mari. Cette loi de la coverture, issue de la common law, représentait selon Kate Morgan « l’incarnation ultime de la subordination féminine dans le mariage, transformant les femmes mariées en simples biens appartenant à leurs époux. » En analysant des affaires d’enlèvement de femmes mariées, telles que Cochrane (1840) et R. c. Jackson (1891), Kate Morgan déduit que le droit matrimonial anglais, notamment la restitution des droits conjugaux accordés aux époux, consacrait un système « tributaire des caprices du mari » qui réifiait la femme. Malgré des avancées législatives comme le Married Women’s Property Act de 1870 et le Civil Partnership Act de 2004, les problématiques de contrôle conjugal persistent dans la société contemporaine anglaise.
En 2024, le Royaume-Uni a enregistré 242 demandes d’ordonnances de protection contre le mariage forcé (FMPO), injonctions destinées à protéger des personnes enlevées ou séquestrées par leur famille/conjoint dans le but de les contraindre au mariage ou de les maintenir dans une union non consentie. Dans certaines régions du monde, la situation demeure comparable à celle de l’Angleterre victorienne. Au Yémen, par exemple, l’article 40 de la loi relative au statut personnel (loi n° 20 de 1992) impose l’obéissance de la femme à son mari, notamment en limitant ses déplacements en dehors du domicile conjugal et en exigeant qu’elle ait des relations sexuelles avec lui. En outre, les mariages forcés et la vente/traite des épouses demeurent des pratiques préoccupantes dans certaines régions d’Afrique, d’Asie et d’Eurasie. Selon Save the Children, « une fille est mariée toutes les 30 secondes dans les pays classés comme États fragiles. »
Divorce
« La fiction juridique la plus dangereuse est l’idée que la loi s’applique également à tous. » – Kate Morgan (p.17)
Parmi les législations victoriennes et édouardiennes empreintes de ce que Kate Morgan qualifie de « double standard législatif », celles relatives au divorce en constituent l’exemple le plus frappant. Le système juridique anglais du XIXᵉ siècle distinguait deux types de séparation matrimoniale : le divorce a vinculo matrimonii (dissolution du lien matrimonial) qui rompait définitivement le mariage et ouvrait la voie à un éventuel remariage, et le divorce a mensa et thoro (séparation de corps et de biens) qui permettait aux époux de vivre séparément sans pour autant dissoudre le mariage. Kate Morgan explique que la doctrine juridique fondamentale du divorce demeurait ancrée dans ses racines bibliques avec l’adultère comme seul motif recevable pour demander la séparation matrimoniale. Toutefois, dans la pratique, cette règle s’appliquait de manière profondément inéquitable. Pour un homme, l’adultère de son épouse lui conférait un droit absolu au divorce, sans condition supplémentaire. En revanche, le droit d’une femme à demander la séparation était soumis à des restrictions considérables, l’infidélité masculine à elle seule jugée insuffisante. Dès lors, pour qu’une demande de divorce féminine soit recevable, l’adultère du mari devait être accompagné d’une circonstance aggravante comme la bigamie, l’abandon du domicile conjugal ou des actes de cruauté.
Kate Morgan illustre cette asymétrie à travers l’affaire emblématique Evans c. Evans (1790), dans laquelle Madame Evans réclamait un divorce pour « cruauté », requête qui lui fut catégoriquement refusée faute de preuves suffisantes. « Cette affaire a établi qu’une épouse devait être capable de démontrer, au-delà de tout doute, qu’elle courait un danger physique imminent si elle restait dans le mariage. Ce précédent a non seulement influencé profondément la législation ultérieure sur le divorce, mais a également façonné les attitudes contemporaines envers la violence domestique, en fixant un seuil minimal de mauvais traitements que les femmes devaient s’attendre à endurer dans un mariage abusif. » La condition préalable de « cruauté matrimoniale » (saevitia) fut finalement rayée du droit anglais par le Divorce and Matrimonial Causes Bill de 1920, puis définitivement rejetée par les New Matrimonial Causes de 2020. Rappelons toutefois que le « no-fault divorce » n’existe en Angleterre que depuis cinq ans et qu’en 2015, 39 % des femmes victimes de violences domestiques ne disposaient d’aucun des éléments de preuve requis pour bénéficier de l’aide juridictionnelle conformément au Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act (Laspo) de 2012 (délai peu réaliste et critères de preuve trop stricts).
Violences domestiques et féminicides
« Comment la justice pouvait-elle être rendue lorsque la principale place réservée à une femme dans la salle d’audience était celle de victime ? » – Kate Morgan (p.177)
Les meurtres d’Elizabeth Biles/Laura Glendell (1896), de Phyllis Dimmock/Dora Piernick (1907), de Ruth Hadley (1908), d’Elizabeth Fallon (1909) et d’Elizabeth Ellis (1917) mettent en exergue une réalité juridique et sociale fondamentale, encore largement présente de nos jours : l’homicide d’une femme était couramment excusé ou minimisé sous le fallacieux prétexte du « crime passionnel » lorsque la victime était perçue comme ayant « provoqué » son époux ou son partenaire. Le message implicite de cette « unwritten law » était que la provocation et l’infidélité féminines constituaient une circonstance atténuante permettant de requalifier un meurtre en homicide involontaire et de justifier la violence masculine, même sous ses formes les plus extrêmes et létales. En dépit des avancées législatives, comme le Aggravated Assault Act de 1853 (première infraction explicitement fondée sur le genre) et le récent Domestic Abuse Act de 2021, les féminicides et les violences domestiques d’antan « résonnent avec les récits contemporains de violences conjugales ».
Les statistiques actuelles révèlent qu’en moyenne, une femme est tuée par un homme tous les trois jours sur le territoire britannique, principalement par son partenaire actuel ou ancien. Par ailleurs, selon les chiffres recueillis pour l’année 2024, 72,5 % des victimes de crimes liés à la violence domestique étaient des femmes. À l’échelle mondiale, six femmes sont tuées chaque heure par des hommes, la plupart du temps issus de leur propre famille ou couple. De plus, l’inefficacité du système judiciaire anglais face à ces violences révèle des similitudes historiques frappantes. D’après Kate Morgan, en 1891, le député Walter McLaren rapportait que sur 8 075 agressions ayant fait l’objet de poursuites, seulement 43 cas (environ 0,5 %) avaient conduit à une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans. Cette impunité quasi générale trouve une résonance contemporaine dans les statistiques de 2025. À peine 5,7% des délits de violence domestique enregistrés par la police britannique aboutissent à une condamnation et moins de 4% de toutes les victimes estimées de violences domestiques voient leur agresseur condamné.
Le gouvernement britannique constate lui-même que « la confiance dans les organismes de justice pénale et dans leur capacité à répondre efficacement aux abus domestiques est à son plus bas niveau historique. »
« Si la femme meurt, on parle d’homicide involontaire, si elle survit, il s’agit d’une agression ordinaire. » – Florence Fenwick Miller (1888) dans The Walnut Tree (p.260).
Violences sexuelles et prostitution
À ce « double standard légilsatif » s’ajoute un « double standard sexuel » dans le traitement des femmes par les lois britanniques, particulièrement manifeste dans la réglementation de la prostitution et des rapports sexuels. Kate Morgan consacre une partie substantielle de son livre à présenter les conséquences dévastatrices des Contagious Diseases Acts (1864-1869), lois qui conféraient aux forces de police la prérogative d’appréhender toute femme suspectée d’être une « common prostitute » et de la contraindre à se soumettre à un examen médical pour dépister d’éventuelles maladies vénériennes. Cette législation se révélait profondément discriminatoire dans son application : seules les femmes pouvaient être arrêtées arbitrairement et soumises à des examens médicaux invasifs sans consentement, alors que leurs clients et maris échappaient totalement à ce contrôle. Les arrestations partiales, voire fatales, de Jenny Percy (1875), Harriet Hicks (1870), Elizabeth Cass (1887) et Annie Coverdale (1888) sont l’illustration d’une violence institutionnelle ciblant spécifiquement les femmes, avec des intrusions systématiques dans leur vie privée et dans leur corporalité. Même après la révision du Vagrancy Act en 1898, cette asymétrie n’a pas fondamentalement été remise en question. Il aura fallu attendre les années 1980 pour que de nouvelles infractions visant spécifiquement la sollicitation de relations sexuelles par des hommes soient créées. Il convient également de mentionner la négligence totale pour le consentement et l’absence de prise en charge des agressions sexuelles que souligne Kate Morgan dans son analyse des Matrimonial Acts de 1870 et 1920. Ces textes législatifs « suggèrent non seulement que le mariage donne un consentement général aux relations sexuelles, mais également que ce consentement est irrévocable pendant toute la durée du mariage ». Cette absence de consentement matrimonial constituait peut-être l’expression la plus explicite de la réduction des femmes au statut de propriété maritale.
Bien que le Contagious Diseases Acts Repeal Act de 1886 et la reconnaissance tardive du viol conjugal comme infraction pénale en 1991 (R. c. R de la Chambre des Lords) ont marqué un changement dans la législation, les attitudes face au viol et à la prostitution, héritées du XIXᵉ siècle, perdurent. Concernant la prostitution, la situation demeure ambivalente et problématique. Bien que l’échange de services sexuels contre rémunération soit techniquement légal au Royaume-Uni, il n’existe pas de législation spécifique protégeant les travailleur·euses du sexe en tant que groupe distinct. Au contraire, de nombreux aspects liés à cette activité restent largement criminalisés, notamment par le Sexual Offences Act de 2003. Cette criminalisation affecte de façon disproportionnée les femmes qui représentent environ 88% des travailleurs du sexe au Royaume-Uni, dont la majorité sont des mères de famille. L’indifférence à l’égard du viol conjugal est également manifeste dans les attitudes contemporaines. En effet, un sondage YouGov datant de 2018 a mis en lumière que 25% des adultes britanniques ne considéraient toujours pas les relations sexuelles non consenties dans le cadre du mariage comme constituant un viol ! La situation est encore plus préoccupante à travers le monde. Le nouveau code pénal indien, ou Bharatiya Nyaya Sanhita (2024), maintient « l’exemption du viol conjugal » au titre de l’article 63 qui dispose que « les rapports sexuels ou les actes sexuels d’un homme avec sa propre femme ne sont pas un viol. » De façon similaire, l’article 375 du code pénal malaisien dispose que « les rapports sexuels d’un homme avec sa propre femme dans le cadre d’un mariage valide en vertu de toute loi écrite actuellement en vigueur, ou reconnu comme valide en Malaisie, ne constituent pas un viol. »
Le Noyer de Kate Morgan se distingue par sa manière subtile mais saisissante d’inviter à une mise en perspective entre le XIXᵉ siècle britannique et notre époque contemporaine : d’une part, pour mesurer les avancées des droits des femmes à l’échelle mondiale (CEDAW, Déclaration de Pékin, résolution 1325 du Conseil de sécurité, Protocole de Maputo, Convention d’Istanbul), et d’autre part, pour rappeler avec conviction que la cause des femmes ne saurait être considérée comme acquise tant qu’elle ne sera pas universelle et accomplie. « Deux décennies après le début du XXIᵉ siècle, nous sommes confrontés à des questions concernant le statut juridique des femmes, des questions que l’on croyait pourtant résolues un siècle plus tôt. L’écart salarial entre les hommes et les femmes, le divorce sans égard à la faute, les violences domestiques et les violences mortelles à l’encontre des femmes font constamment la une des journaux. »
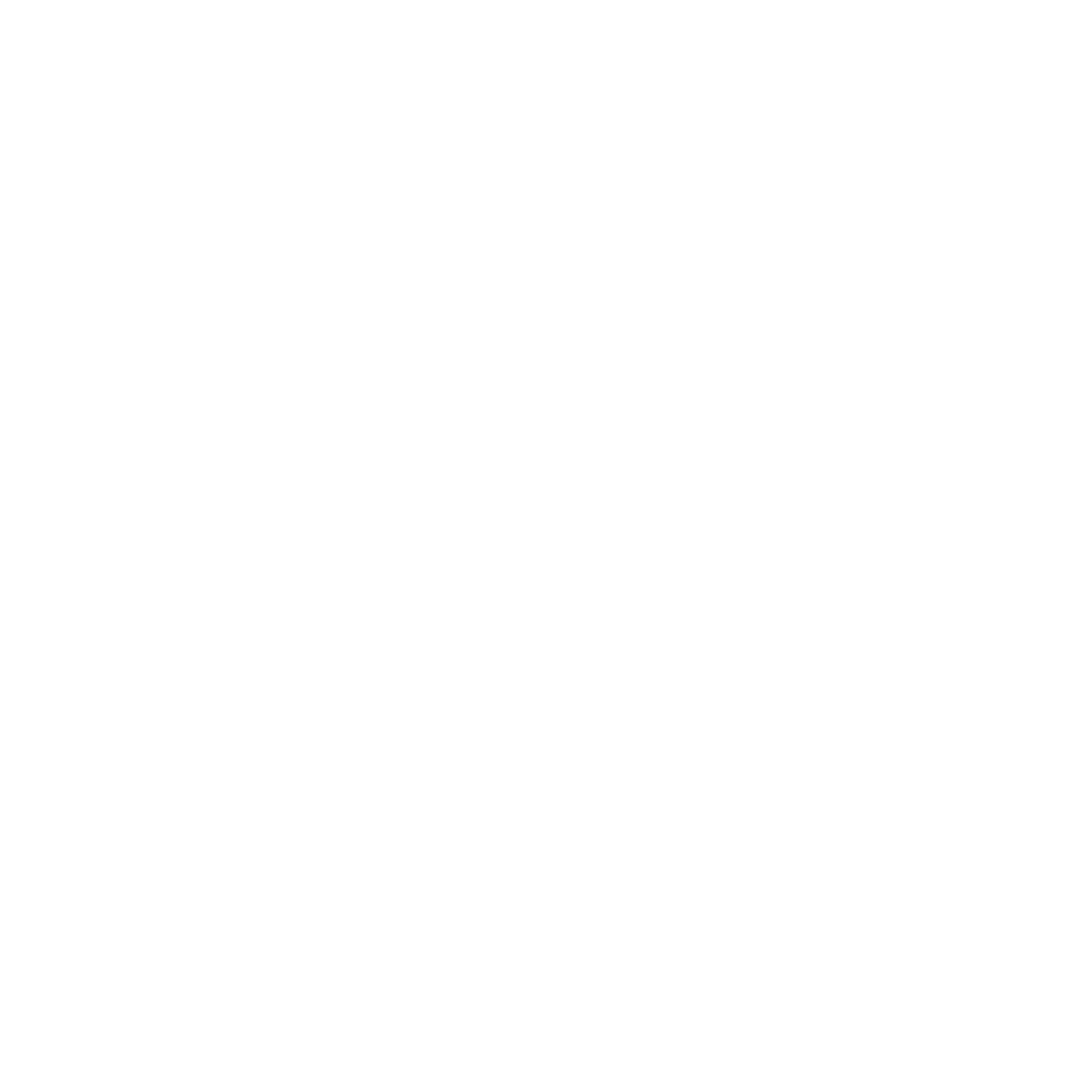
Laisser un commentaire