Entretien avec Christophe Cotteret : « En légitimant un regard déshumanisant sur l’autre, nous avons fragilisé les fondements mêmes de l’humanisme construit après la Seconde Guerre mondiale »

Christophe Cotteret, cinéaste documentaire et journaliste français, a vécu à Beyrouth entre 2002 et 2006, période durant laquelle il est témoin du conflit israélo-libanais. De cette expérience est née sa détermination à comprendre les dynamiques sociopolitiques contemporaines du Moyen-Orient, puis à diversifier progressivement son champ d’investigation vers le continent africain. Son premier long métrage documentaire, « Démocratie, année zéro » (2013), coréalisé avec Amira Chebli, marque un tournant dans sa carrière de documentariste qui s’oriente alors vers la thématique des violences politiques. S’ensuit une série de documentaires qui interrogent, à travers différentes crises, les liens entre les sociétés et les politiques nationales et internationales : « Ennahdha, une histoire tunisienne » (2014), « Inkotanyi : Paul Kagame et la tragédie rwandaise » (2017), « Daech, le dilemme de la justice » (2019), « 13 novembre 2015, anatomie d’une instruction » (2022), « White Power, au cœur de l’extrême droite » (2023) et, plus récemment, « Disunited Nations – Proche-Orient : l’ONU dans la tourmente » (2025). L’approche narrative de Christophe Cotteret se caractérise par une « attention méticuleuse aux nuances historiques et aux témoignages empiriques », invitant à une réflexion sur les responsabilités inhérentes à chaque acteur, y compris celles des puissances coloniales et impérialistes d’antan. En outre, il mobilise avec rigueur les archives visuelles, qu’il intègre aux récits contemporains afin d’expliciter les continuités, les ruptures et les mécanismes du pouvoir et de la violence politique.
Remerciements
Dans le cadre de mes études et de mon intérêt pour les enjeux humanitaires et leurs acteurs, le documentaire est un outil qui m’est tout aussi indispensable que le livre. Le travail de Christophe Cotteret m’accompagne depuis plusieurs années, et à la sortie de Disunited Nations, j’ai souhaité comprendre la sensibilité, la rigueur et la justesse avec lesquelles il dépeint les coulisses des événements géopolitiques du XXIe siècle. Ses images dessinent une continuité, qui s’étend pourtant sur des milliers de kilomètres : celle des conséquences d’une décision gouvernementale ou institutionnelle qui se propagent à la manière de ricochets successifs, chaque impact produisant un son nouveau dans un même lac de violence. Elles laissent ainsi affleurer les paroles, les chagrins et les colères de celles et ceux auxquels l’écran n’est pas suffisamment consacré. Je remercie Christophe Cotteret pour son temps, pour son œuvre que j’espère voir perdurer, et pour ses réflexions qu’il a accepté de partager sur Majuscule.
L’entretien en intégralité
Votre premier long métrage documentaire, Démocratie, année zéro (2013), a pour sujet la révolution tunisienne de 2011, et propose un regard inédit sur cet événement : celui de « la mécanique d’une révolution sans idéologie ni leader », dont les prémices remontent aux révoltes de Gafsa et de Redeyef en 2008. Aujourd’hui, c’est le peuple iranien qui se soulève, comme en Tunisie il y a quelques années, sans idéologie ni leader, mais uni par une même aspiration à la liberté et à la justice sociale. J’aimerais vous poser deux questions qui permettront de rapprocher votre documentaire à la situation actuelle en Iran. Premièrement, vous accordez une place importante aux opposantes révolutionnaires tunisiennes, comme Lina Ben Mhenni (alias Tunisian Girl) ou encore aux femmes du sit-in d’avril 2008. Depuis le 28 décembre 2025, les Iraniennes sont à l’avant-garde de la contestation contre le régime des mollahs et le pouvoir d’Ali Khamenei, comme elles l’ont été en 2022 lors du mouvement « Femme, Vie, Liberté». Selon vous, quel est l’intérêt pour le monde du documentaire de rendre visibles les femmes dans les luttes révolutionnaires, tant du point de vue du récit que de la compréhension politique et sociale de ces mouvements ?
Christophe Cotteret : En Tunisie, et à Gafsa en particulier, les femmes ont joué un rôle absolument essentiel pour une raison très concrète. Les hommes, et notamment les syndicalistes masculins, ont été incarcérés en 2008. Dans ce contexte, ce sont les femmes qui sont restées pour manifester, ce sont elles qui ont investi l’espace public. Il existait également à Gafsa une spécificité que j’avais trouvée intéressante et parlante. Les policiers tunisiens, qui ne sont évidemment pas comparables aux gardiens de la révolution en Iran, n’avaient pas l’habitude de faire face à des manifestantes. Ils avaient peur de les frapper parce qu’il y avait en face d’eux une mère, une voisine, une sœur, etc. Plus largement, la Tunisie est un pays où la résistance portée par les femmes a toujours été forte. L’Association tunisienne des femmes démocrates, par exemple, s’est imposée comme un acteur central non seulement dans les luttes pour les droits des femmes, mais aussi pour l’ensemble des libertés. Après tout, il n’y a pas de droits des femmes sans droits humains tout court.
Cela dit, je reste prudent face à une médiatisation excessive des femmes dans des contextes révolutionnaires. Ce n’est pas parce que leur combat ne serait pas légitime. En Iran, la vie des femmes est soumise à une répression structurelle depuis 1979. Il existe donc une revendication singulière, propre aux femmes iraniennes, et il est évident qu’elles méritent toute notre attention et tout notre soutien. Elles sont nombreuses, affrontent un danger réel – un danger de mort – et se battent pour leur liberté et l’avenir du pays, coûte que coûte. Mais il y a un regard dont je me méfie, y compris dans mon travail d’iconographie en tant que réalisateur, et je pense que les journalistes, hommes et femmes, devraient également s’en méfier : ce regard est celui de l’Occident, où l’on a tendance à voir les femmes moyen-orientales uniquement comme des êtres opprimés par les hommes, par l’Islam. C’est une façon de considérer les sociétés qui rappelle le regard colonial et orientaliste que nous portions sur les sociétés que nous dominions. Il s’agit de projeter notre propre système de pensée, notre propre grille de lecture. Cela s’accompagne parfois d’un racisme latent à l’égard des hommes, qu’il faut interroger et contenir. Il y a là ce regard néocolonial et racialisant qui explique en partie pourquoi nous insistons tant, parfois exclusivement, sur les femmes dans les luttes du monde arabo-musulman. Les femmes sont certes présentes dans ces luttes, et il est important de les montrer, mais cela ne doit pas devenir le seul prisme. Ce sont toutes les luttes qui doivent être visibles.
Ma seconde question porte sur la cyberdissidence et la guerre médiatique menée contre la censure et la répression des autorités gouvernementales. Démocratie, année zéro montre comment les cyber-activistes tunisiens, rejoints par des avocats, ont contribué à transformer une contestation sociale en processus révolutionnaire, par la mobilisation sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, les Iraniens sont privés d’Internet et subissent une répression d’une violence et d’une ampleur inouïes. Comment évaluez-vous l’efficacité, mais aussi les limites de la guerre médiatique face à un régime autoritaire, et pensez-vous que l’Iran puisse, à son tour, passer d’une contestation sociale à une révolution ?
Il y a d’abord la question du renversement du pouvoir. En Tunisie, Ben Ali a effectivement été renversé, et les réseaux sociaux ont joué un rôle déterminant. Leur action s’est déployée sur deux terrains. D’une part, celui de la mobilisation intellectuelle et politique, notamment via Facebook, où les échanges, le relais de l’information et la coordination se sont progressivement structurés. D’autre part, sur le terrain de la visibilité et de la sensibilisation, comme l’a montré l’arrestation de Hamadi Kaloutcha et de plusieurs cyberactivistes en janvier 2011, ce qui a soudé et renforcé la mobilisation. La nouveauté apportée par les réseaux sociaux était que les informations circulaient en temps réel : on indiquait où se retrouver, on signalait la présence des forces de l’ordre, puis on changeait de lieu lorsque celles-ci avaient anticipé un point de rassemblement. Cela a aussi été le cas dans les villages où l’objectif était d’épuiser la police. Les manifestants se relayaient jour et nuit, sans leur laisser de temps de repos. Au bout de quelques semaines, les forces de l’ordre étaient exténuées. À Gafsa, par exemple, le commissaire s’est retrouvé sans munitions et a dû faire appel à l’armée. Lorsque celle-ci est arrivée, elle a refusé de tirer sur la population. Ce schéma s’est reproduit dans tout le pays et à un moment donné, ce sont les manifestants qui ont remporté le bras de fer contre la police. Il m’a donc semblé important de montrer que les révoltes populaires l’emportent lorsque l’État n’est plus en mesure d’y répondre. Finalement, « l’erreur » majeure de Ben Ali a été de ne pas couper Internet. En Iran, au contraire, la première décision a été de couper Internet : la population ne peut plus communiquer et la répression se déroule à huis clos.
En Iran, la situation est plus complexe, car on est face à un système différent. Il ne s’agit pas de policiers ordinaires, ni d’un contexte comparable à celui de l’Égypte ou de la Tunisie, où une armée professionnelle peut hésiter. En Iran, la limite est d’une autre nature. En tant qu’observateur, sans me prétendre spécialiste du pays, il me semble que les gardiens de la Révolution opèrent à une autre échelle. Leur loyauté ne va pas au peuple, mais au régime, à la Révolution et au guide suprême. C’est un point central, car cela rend la répression beaucoup plus dure. Même dans une stratégie d’épuisement, face à une majorité de la population ou à des manifestants aguerris cherchant à bloquer le pays et les forces de l’ordre, les gardiens de la Révolution sont formés pour faire face à ce type de situation. Un autre point essentiel est que la chute d’un régime ne signifie pas nécessairement une révolution. Une révolution implique un changement profond des institutions et des structures. Dans plusieurs cas, notamment en Égypte, la révolution de 2011 a débouché, deux ans plus tard, sur un régime qui s’était en réalité parfaitement préservé. En Tunisie, la révolution a également produit sa propre restauration, notamment avec Kaïs Saïed. Cela m’amène à me méfier des révolutions lorsqu’il n’y a pas de transformation institutionnelle profonde. Se pose alors la question des opposants, de leur capacité à gouverner, des institutions à démanteler ou non. Ce sont souvent ces questions-là, les plus complexes, qui suivent la chute d’un régime. Parce que les régimes apprennent les uns des autres. Ils apprennent à mater les révoltes, mais aussi à préserver leurs intérêts financiers et structurels, même en cas de chute temporaire. Dans le monde arabo-musulman que j’étudie depuis plusieurs années, les régimes ont une forte capacité de résilience : Kadhafi a tiré des leçons de la Tunisie, Bachar al-Assad de la Libye. C’est pour cette raison, et au vu du bilan de la répression, que je dirais que l’Iran présente une dynamique de révolte révolutionnaire bien réelle, sans trop m’avancer dans mes propos.
Le problème, au fond, tient surtout à notre incapacité à agir autrement qu’en observateurs. Documenter est essentiel, mais nous avons largement échoué à construire une relation durable avec l’Iran. Cette difficulté s’inscrit dans une histoire longue. L’ouverture sous Mohammad Khatami n’a pas été réellement saisie par l’Occident, notamment par les États-Unis, et la mémoire du renversement de Mohammad Mossadegh en 1953, soutenu par la CIA et les Britanniques, reste très présente. Soixante-quinze ans d’erreurs accumulées rendent toute intervention extrêmement délicate. Le recours à la force, comme l’a suggéré Trump, me paraît peu efficace. Après des décennies d’embargos et de pressions, les Iraniens ont développé une capacité de résistance qui limite fortement l’impact des injonctions occidentales en matière de droits humains.
Votre documentaire le plus récent, Disunited Nations – Proche-Orient : l’ONU dans la tourmente (2025), suit Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations unies sur les territoires palestiniens occupés, et révèle comment son travail juridique sur le génocide des Palestiniens a fait l’objet de campagnes de désinformation. Vous montrez comment ses propos ont été sortis de leur contexte, déformés, et comment des accusations infondées d’antisémitisme ont été relayées par les médias et l’ONG UN Watch. En réalisant ce film, avez-vous été confronté à des tentatives de discrédit ou à des obstacles pour rendre compte fidèlement du travail de Francesca Albanese et de la réalité du terrain ? Face à une situation juridiquement établie et largement documentée, celle d’un génocide, ressentez-vous un « devoir de documentation » ?
C’est le premier film que je réalise pour lequel il n’y a eu aucun article de presse en France. Cela fait pourtant des années que je fais des films, et jusqu’ici, qu’ils soient jugés bons ou mauvais, ils ont toujours suscité un minimum d’attention médiatique. Cette fois, rien. Pas un article, ni dans la presse écrite, ni en ligne. Je tiens à le préciser, parce que ce n’est pas une question de qualité. Je peux entendre qu’on le critique, qu’on dise qu’il n’est pas bon, mais ce n’est pas le sujet. Je suis largement interviewé en Suisse, en Italie et dans plusieurs autres pays. En France, en revanche, seuls quelques médias indépendants, identifiés comme étant à gauche ou proches de La France Insoumise, m’ont donné la parole. Je ne dis pas cela pour me plaindre, mais parce que cela s’inscrit dans une logique plus large, celle d’une campagne de diffamation massive que subit Francesca Albanese depuis la publication de son rapport Anatomy of a Genocide (2024). La diffamation consiste à lui faire dire ce qu’elle n’a jamais dit, à sortir ses propos de leur contexte, à construire une mécanique visant à la discréditer. On l’a ainsi associée à l’UNRWA, en recyclant de vieilles accusations infondées, simplement parce qu’elle y a travaillé. Ces fausses informations ont même visé son entourage personnel, comme lorsque son mari a été accusé d’avoir reçu de l’argent de l’Iran ! Ce qui est frappant, c’est que cette stratégie de diffamation fonctionne en vase clos. Des soutiens du gouvernement Netanyahou, ou plus largement du projet politique porté par l’actuel pouvoir israélien, les relaient en les citant comme sources, alors qu’elles proviennent du même circuit. On assiste ainsi à une production continue de fausses informations qui s’autoalimentent et finissent par s’imposer dans le débat public.
Concernant ma propre personne et mon dernier documentaire, j’ai pu lire des commentaires affirmant que les images du film étaient générées par l’intelligence artificielle, que je mentais et que je n’étais pas un vrai journaliste. Certains commentaires rappelaient que Francesca Albanese avait été condamnée pour antisémitisme, ce qui est faux, et qu’elle aurait des liens avec le Hamas, ce qui est également faux et infondé. L’objectif n’est pas tant de produire une contre-vérité crédible que de faire perdre du temps et de semer la confusion. ARTE, qui a simplement fait son travail en produisant ce film, comme pour Inside Gaza, s’est aussi retrouvé confronté à un déferlement de commentaires haineux. La question s’est alors posée de savoir s’il fallait y répondre. Ma position a été claire. Répondre, c’est souvent se placer sur la défensive face à des accusations sans preuve. Or, dans ce type de situation, la charge de la preuve incombe à ceux qui accusent. Je tiens à souligner que ce mécanisme n’est pas nouveau. Les médias sont toujours partie prenante des processus de violence de masse, qu’il s’agisse de génocide ou de nettoyage ethnique. À un moment donné, il faut nommer l’autre, le discriminer et lui retirer son humanité. Cette déshumanisation passe par des étapes qui ne peuvent se déployer sans le rôle des médias. On l’a déjà vu dans l’histoire. La propagande antisémite des années 1930, la propagande antimusulmane serbe pendant la guerre de Yougoslavie, ou encore Radio télévision libre des Mille Collines au Rwanda en 1994. Le mécanisme est toujours le même : on prépare le terrain par la déshumanisation. Les génocidaires ont besoin de cette étape pour obtenir l’adhésion, ou au moins la passivité, d’une partie de l’opinion publique. Puis vient le temps du négationnisme, qui est sans doute la phase la plus longue et la plus durable. Cent dix ans après, le génocide des Arméniens continue d’être nié par certains. C’est précisément là qu’intervient le documentaire dans son devoir de documentation, car les faits seuls ne suffisent pas et il faut les mettre en perspective, leur donner un cadre historique et politique. Il s’agit de se préparer déjà à combattre le négationnisme qui suivra. J’ai travaillé sur ces questions auparavant, notamment avec un film consacré au Rwanda, Inkotanyi : Paul Kagame et la tragédie rwandaise (2017). Et ce que je ressens aujourd’hui, dans les débats auxquels je participe, c’est une impression de déjà-vu. Celle d’un déni qui s’installe, comme à l’époque, et qui prépare les récits de demain.
En 2019, vous avez réalisé Daech, le dilemme de la justice, un documentaire qui tente de répondre à la question : « Comment et où juger les milliers de Français, de Belges et de Tunisiens partis rejoindre les rangs de l’État islamique ? » Ce qui transparaît ici, c’est que le déni de justice et la violation du droit à un procès équitable pour les terroristes constituent un terreau fertile et durable pour la violence : de Guantánamo aux procès expéditifs en Tunisie, en passant par le sort réservé aux femmes et aux enfants des combattants étrangers détenus dans les camps en Syrie ou transférés vers l’Irak pour être « jugés ». Comment avez-vous concilié, dans l’écriture et la réalisation de ce film, la défense du droit international avec une condamnation sans ambiguïté du terrorisme, tout en assumant le choix de montrer les auteurs de ces crimes comme des justiciables ordinaires ? Quelle finalité cherchez-vous à transmettre à travers cette « humanisation » potentiellement difficile à entendre pour les victimes et leurs proches ?
Je pense qu’il est important d’humaniser, y compris les terroristes. Je ne suis pas un État, je ne déshumanise pas. Le rôle de la justice est précisément d’humaniser pour comprendre et pour juger. Comprendre ne signifie évidemment pas excuser et je ne remets pas en cause la lutte contre Daech en Syrie, d’autant que les Syriens ont été les premières victimes de ce terrorisme. Mais déshumaniser empêche de comprendre, et sans compréhension, on ne saisit rien au phénomène. Ce qui m’avait frappé à l’époque, y compris dans certains discours judiciaires et médiatiques, c’était l’idée que les terroristes seraient nés tels quels. Comme s’ils étaient apparus soudainement, porteurs d’une mission mystique, frappés par une révélation religieuse, et passés à l’acte sans autre explication. Nous n’étions pourtant plus en 2015-2017, et Daech avait déjà été militairement vaincu. Je n’aurais d’ailleurs pas réalisé ce film au moment des attentats, alors que l’émotion était encore trop vive et le recul insuffisant. En 2018 et 2019, il était donc possible de commencer à analyser le phénomène avec plus de recul et de constater qu’il s’agissait avant tout d’un fait politique. Il existe bien sûr une dimension religieuse, notamment dans le djihadisme sunnite, mais après avoir rencontré certains de ses acteurs et mené de nombreux entretiens, il apparaît que les motivations sont d’abord politiques. Déshumaniser une motivation politique, aussi abjecte soit-elle dans ses objectifs et dans ses méthodes, ne nous aide pas à avancer. C’est ce constat qui guide mon travail de documentariste en 2019.
L’autre point central concernait le sentiment de justice. Y compris parmi les familles de victimes, notamment celles du Bataclan, les positions étaient parfois partagées. Certains estimaient qu’il fallait simplement exécuter les terroristes et clore le débat. Or, cette logique ne fonctionne pas. L’exécution ne met pas fin au phénomène. Lorsqu’on répond uniquement par la force, sans travailler sur les causes politiques et sociales du terrorisme, celui-ci se prolonge, se transforme et réapparaît ailleurs. Après 2015, on a largement privilégié une réponse strictement sécuritaire, sans s’attaquer aux racines du problème. Encore une fois, cette approche ne fait que repousser l’échéance et favorise de nouvelles formes de violence. C’est précisément ce que le film interroge. Que faire, juridiquement, des ressortissants partis rejoindre Daech ? Certains États, comme la France, ont choisi de faciliter leur transfert vers l’Irak, faute de pouvoir les juger en Syrie. Là-bas, ils ont été condamnés à l’issue de procès expéditifs (quelques minutes) débouchant sur des peines de mort. La Tunisie, de son côté, refusait de rapatrier ses ressortissants, faute de moyens, laissant des femmes et des enfants, pourtant innocents, dans des camps au Kurdistan. On a ainsi choisi de déplacer le problème plutôt que de l’affronter, au risque de compromettre durablement la stabilité de la région, comme l’ont souligné les Kurdes eux-mêmes ! Au fond, nous avons contribué à créer cette situation, nous avons créé nos propres monstres, puis nous avons tenté de les enfouir. Or, un phénomène politique ne se résout pas par des assassinats ciblés. La justice est incontournable. Et la justice, ici, signifie traiter ce phénomène en profondeur. Humaniser, ce n’est pas excuser : c’est rendre possible une réponse politique et juridique capable, enfin, de rompre le cycle de la violence.
Alors que l’année 2025 a confirmé l’enracinement de l’extrême droite en Europe (e.g. « Make Europe Great Again »), visible aussi bien dans les urnes que dans l’espace public, votre documentaire White Power : au cœur de l’extrême droite (2023) illustre comment ces idées se diffusent, se normalisent et se reconfigurent désormais largement à travers les influenceurs et les idéologues identitaires. Quelles sont les implications de ce déplacement du pouvoir idéologique de l’extrême droite européenne des partis politiques vers les réseaux sociaux, accompagné d’une inversion du rapport entre militantisme numérique et action partisane ? Les dispositifs de type « cordon sanitaire », comme ceux mis en place en Belgique francophone, sont-ils une réponse suffisante face à cette vague brune ?
Ce que j’ai réellement mesuré en travaillant sur White Power, même si je m’en doutais déjà, c’est l’obsession de la question migratoire, aussi bien chez les cadres que chez les électeurs de l’extrême droite. On répète souvent que l’immigration n’est pas la première préoccupation des Français, et c’est sans doute vrai. Les priorités restent économiques, sociales, liées à la santé, au logement ou aux transports. Mais la question migratoire fait aujourd’hui la différence politique. Elle est devenue une obsession mondiale. De Trump à Milei, jusqu’à une large partie des dirigeants européens, les discours convergent. Et surtout, les réponses apportées ne diffèrent presque plus entre la droite et l’extrême droite, voire le centre droit. Cette convergence se manifeste par la limitation du droit d’asile, la restriction des naturalisations, le durcissement des politiques de visas à l’égard des populations extra-européennes, etc. La prochaine étape, c’est l’externalisation de la question migratoire, et là, on entre dans quelque chose de beaucoup plus grave. L’Union européenne, dominée par des forces de droite au Parlement, a fait le choix de déléguer cette politique à des pays tiers. En Tunisie, des personnes sont aujourd’hui arrêtées sur des critères raciaux et abandonnées dans le désert. En Libye, avec le soutien financier de l’Italie et de l’Union européenne, des camps d’internement retiennent des milliers, parfois des dizaines de milliers de migrants subsahariens. Les violences, les viols, les meurtres et la torture y sont documentés. L’Union européenne le sait. Des projets similaires ont été envisagés en Albanie, heureusement bloqués, pour l’instant, par la justice italienne. On voit ainsi se multiplier des zones de non-droit destinées à empêcher les populations de circuler. Pour moi, il faut le rappeler clairement, l’immigration est un droit. Aujourd’hui, l’immigration est pensée presque exclusivement comme un problème. Et sur ce point, il existe une forme de continuité idéologique qui va d’Emmanuel Macron à Jordan Bardella ou Éric Zemmour – les différences tiennent davantage à des nuances qu’à une rupture de fond.
Ce qui change réellement, en revanche, c’est l’apparition centrale de la notion de remigration. À l’échelle européenne, toutes les extrêmes droites s’accordent sur cette idée. Le principe est le même, celui du renvoi des populations considérées comme étrangères à l’Europe : 1) D’abord, stopper l’immigration, 2) Ensuite, ne pas renouveler les titres de séjour, 3) Puis contrôler, trier, vérifier, 4) Enfin, étape décisive, remettre en question la nationalité elle-même, en évaluant qui serait suffisamment intégrable. Ce qui est plus préoccupant encore, c’est que ce projet ne reste pas cantonné à l’extrême droite. Des droites conservatrices traditionnelles y participent ou s’en rapprochent. En Allemagne, une partie de la CDU s’y est montrée ouverte. Ailleurs en Europe, des courants souverainistes, qui ne se revendiquent pas explicitement de l’extrême droite, s’inscrivent dans cette dynamique. Maintenant, quel rôle jouent aujourd’hui les médias et les réseaux sociaux dans cette dynamique ? Les affrontements idéologiques ne sont pas nouveaux, ils existaient déjà à la télévision, à la radio, dans la presse écrite. Il y a toujours eu des propagandes et des contre-propagandes. Ce qui change aujourd’hui, c’est le contexte et les canaux.
À titre personnel, je pense qu’il est légitime d’interdire les chaînes qui diffusent de la désinformation ou de la diffamation (CNews, C8, etc.). En Allemagne, ce type de médias n’existe pas parce que l’extrême droite n’a simplement pas accès aux grandes chaînes de télévision. Pourtant, on y observe des dynamiques très similaires, avec une extrême droite puissante, structurée, parfois ouvertement néonazie ou révisionniste, proche de mouvements identitaires. Cela montre que l’interdiction de certaines chaînes peut être nécessaire, mais qu’elle ne suffit pas. Elle ne règle le problème qu’à la marge. On ne combat pas un phénomène politique uniquement par des mesures de régulation médiatique. Par ailleurs, il ne s’agit pas de ne pas parler aux électeurs de l’extrême droite, ni de nier les enjeux concrets de politiques publiques, notamment en matière de transport, de logement ou de services publics, qui nourrissent une partie de leur discours. Mais le problème est plus profond. Depuis des années, peut-être depuis la guerre en ex-Yougoslavie, et plus encore depuis le 11 septembre 2001, un récit raciste s’est progressivement imposé et normalisé. Il a traversé l’ensemble du champ politique et médiatique. En légitimant un regard déshumanisant sur l’autre, sur le migrant, sur les minorités, nous avons fragilisé les fondements mêmes de l’humanisme construit après la Seconde Guerre mondiale. Au fond, la bataille des idées a été perdue bien en amont. Les médias n’en sont pas l’origine, mais le vecteur. Ils relaient, amplifient et normalisent des discours qui se sont installés dans l’opinion publique au fil des vingt dernières années.
Pour conclure, j’aimerais vous poser une question plus ouverte et plus personnelle. Indépendamment de vos projets à venir, y a-t-il aujourd’hui un sujet, un territoire ou une crise qui vous semble souffrir d’un manque criant de visibilité documentaire et vers lequel vous aimeriez voir davantage de regards se diriger ?
Il existe aujourd’hui de nombreux terrains dramatiquement sous-documentés. Qui sait ce qui se passe véritablement au Cambodge, surtout depuis le conflit frontalier avec la Thaïlande ? On pourrait également évoquer le Kivu, qui est lui aussi largement négligé. Le cas qui me frappe le plus, c’est celui du Soudan. On commence à peine à comprendre ce qui s’y joue, et encore de manière très fragmentaire. On évoque ponctuellement El Fasher, puis le silence retombe. Tout le monde sait vaguement que la situation y est dramatique, mais les informations circulant réellement sont très rares. Le Soudan s’inscrit en effet dans une dynamique plus large, car il ne s’agit pas seulement d’une catastrophe humanitaire : on assiste à une recomposition profonde des frontières et des rapports de force. On observe une logique de prédation très claire, notamment liée aux ambitions des Émirats arabes unis, une puissance régionale qui cherche à changer d’échelle. Cela passe par des logiques de mercenariat, la transformation des sociétés, notamment en Afrique de l’Est, et la redéfinition des frontières. Ce qui se joue aujourd’hui au Soudan est étroitement lié à ce qui s’est produit en Libye et à ce qui se passe actuellement au Tchad. C’est une question profondément géopolitique qui mérite d’être mieux documentée.
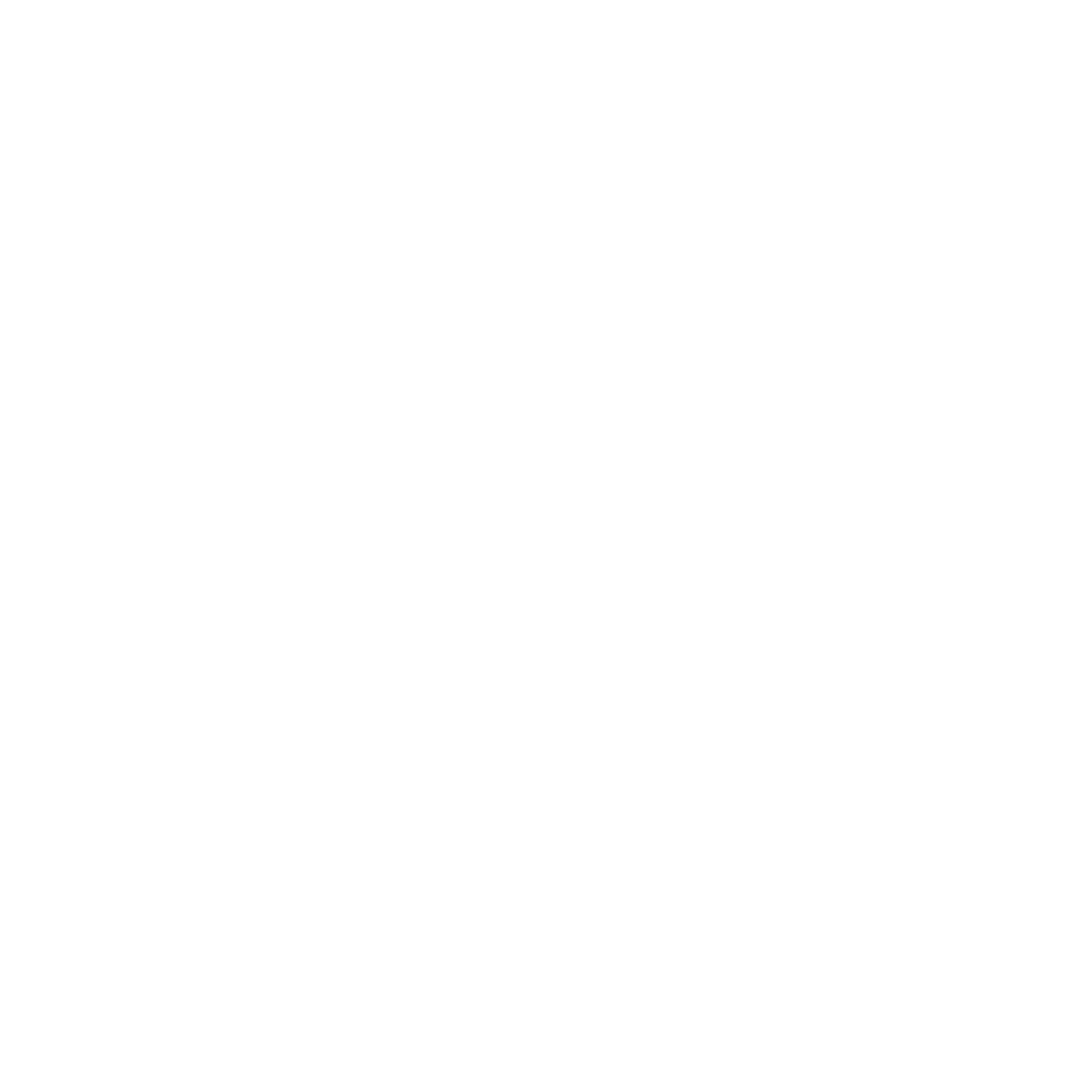
Laisser un commentaire