« Miroirs n° 3 » de Christian Petzold : peut-on faire dialoguer santé mentale et droits humains ?

Jamais nous ne connaîtrons les raisons qui ont poussé Yelena à mettre fin à ses jours – protagoniste absente mais indispensable au récit du nouveau film de Christian Petzold. Son geste bouleverse, casse et trouble le quotidien de ses parents et de son frère, mais également celui d’une jeune étudiante, Laura, qui s’installe temporairement dans la demeure familiale après avoir elle-même souffert d’un deuil. Les dialogues se font volontairement rares et brefs, cédant la place aux non-dits. Ce sont les traits du visage, les plis des yeux ou les rictus de la bouche qui portent le récit, qui racontent et qui révèlent. Le malaise palpable du frère lorsqu’il découvre Laura vêtue des habits de Yelena ; l’émotion muette de la mère quand Laura fait résonner le piano désaccordé de Yelena ; ou encore la tendresse fragile chez le père qui entoure Laura d’un cocon excessivement protecteur : tous ces comportements singuliers demeurent conditionnés par le mal-être auquel a cédé celle qui fut leur centre de gravité.
Après avoir visionné Miroirs n°3, impossible de ne pas pousser la réflexion sur les droits humains vers ses dimensions les plus audacieuses : les personnes en proie à des pensées suicidaires peuvent-elles se tourner vers le droit international ? Question d’autant plus pertinente que ce droit traite généralement de conditions et de situations universelles, franchissant rarement la frontière hermétique du subjectif et de l’intime. Alors, le droit international a-t-il osé se prononcer sur ce sujet qui demeure tabou, y compris dans les sphères les plus confidentielles ?
Il importe d’emblée de différencier les troubles mentaux communs (common mental disorders, CMDs) des troubles mentaux sévères (severe mental disorders, SMDs). Cet article porte spécifiquement sur les CMDs, catégorie englobant la dépression, les troubles anxieux généralisés, les troubles du comportement alimentaire (TCA), les troubles du stress post-traumatique (TSPT) ou encore les troubles obsessionnels compulsifs (TOC). Les SMDs, quant à eux, regroupent des pathologies mentales telles que la schizophrénie, les troubles bipolaires et les diverses formes de psychoses chroniques, qu’elles soient dissociatives ou non. Cette distinction est importante dans la mesure où elle n’est pas opérée, ou de façon insuffisante, par les textes internationaux qui tendent à rassembler ces deux catégories sous l’appellation générique de « troubles mentaux » (mental disorders) ou « maladies mentales » (mental illness). Cette distinction trouve par ailleurs son importance dans l’observation de Stephen P. Marks, Lena Verdeli et Sandra Willis (2020) selon laquelle : « Bien que le discours sur les droits humains dans le domaine de la santé mentale tourne généralement autour des SMD, (…) d’autres violations, telles que le droit à la santé et aux soins de santé, concernent également les CMD. » L’enjeu, que je m’efforce de présenter ici, consiste donc à assurer une protection égale des droits humains, qu’il s’agisse de patients schizophrènes ou dépressifs, sans établir de hiérarchie dans la souffrance ou l’accès aux droits.
La violation des droits humains de personnes atteintes de CMD est aujourd’hui une « urgence mondiale » et une « crise non résolue ». En effet, Carla A. Arena Ventura explique que « les personnes atteintes de troubles mentaux sont exposées à toute une série de violations des droits humains, qui peuvent se produire au sein des institutions, sous la forme de soins et de traitements inadéquats et préjudiciables, mais aussi à l’extérieur, où elles sont confrontées à des restrictions dans l’exercice de leurs libertés civiles et de leurs droits à l’emploi, à l’éducation et au logement. » Ces atteintes se traduisent par des traitements inhumains, des conditions de vie dégradées, des carences en matière de vêtements, d’alimentation et d’accompagnement social et cognitif. Par ailleurs, ces personnes subissent des violations de droits consubstantiels à leur condition sociale, à l’instar des femmes dans l’exercice de leur droit à l’avortement. Dès lors, il faut garantir aux personnes atteintes de CMD le droit à l’autonomie, à la confidentialité et au consentement éclairé en plus du droit universel à la vie privée (art. 12) et aux traitements humains (art. 5). Heureusement, comme le soulignent Stephen P. Marks et ses collègues, les trois dernières décennies ont été marquées par des avancées considérables dans l’élaboration d’une « human rights–based approach » en santé mentale et d’un cadre normatif par les instances internationales.
« La santé mentale n’est pas un privilège mais un droit humain fondamental qui doit faire partie de la couverture sanitaire universelle » – A. Guterres
Établissons sans détour un point capital : oui, le droit international a tout intérêt à faire de la gestion des CMD une priorité, et ce pour trois raisons fondamentales. D’abord parce que « la santé mentale et les droits de l’homme sont inextricablement liés » et que leur relation demeure « complexe et bidirectionnelle ». Artin Mahdanian et al. expliquent que « d’une part, les violations des droits humains peuvent avoir un impact négatif sur la santé mentale, d’autre part la protection des droits humains peut renforcer, voire améliorer, les résultats en matière de santé mentale. » En effet, pour paraphraser Carla A. Arena Ventura, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont la seule source juridique qui offre des protections fondamentales qui ne peuvent être supprimées par le processus politique ordinaire. Ensuite, parce que « la santé mentale devrait constituer l’un des principaux défis pour les systèmes de santé à l’avenir » et que, par répercussion, les troubles mentaux sont susceptibles d’affecter davantage les secteurs sociaux, menaçant ainsi la paix, les droits humains et le développement. Enfin, étant donné que parmi les répercussions sociales des CMD on compte des taux de chômage élevés, le sans-abrisme, de mauvais résultats scolaires et sanitaires, la prévention de ces troubles est en lien direct avec les Objectifs de développement durable adoptés en 2015 (1, 3, 4 et 8). « La santé mentale est pertinente pour tous les objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 3.4.2 traitant spécifiquement de la réduction de la mortalité par suicide. (…) Les personnes souffrant de troubles mentaux sont plus susceptibles de tomber dans la pauvreté, d’être en mauvaise santé physique et d’avoir moins accès à l’ emploi, à l’éducation et aux ressources. » Dans ce contexte, plusieurs instruments et institutions internationaux se sont saisis de cette problématique, proposant un cadre général de gestion et de protection des droits des personnes atteintes de troubles mentaux.
Il convient toutefois d’examiner principalement le droit souple, étant donné qu’ « en termes de hard law, il n’existe aucun traité spécialisé qui définisse des protections juridiques internationales détaillées spécifiques à la santé mentale. Certains traités mentionnent la santé mentale, mais ils ne contiennent pas de dispositions suffisantes, spécifiques à la santé mentale, pour créer des obligations positives pour les États, limiter l’exercice des pouvoirs discrétionnaires en matière de santé mentale ou garantir des recours efficaces en cas de violations ». Cela étant établi, les principaux textes internationaux qui offrent un cadre de protection et de reconnaissance des droits des personnes souffrant de CDM sont :
- Les Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé mentale (Résolution 46/119 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 1991)
- Les dix Principes fondamentaux de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) relatifs à la législation en matière de santé mentale (Principes MHL de l’OMS, 1996)
- La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies (CDPH, 2006)
- La Déclaration de Madrid de l’Association mondiale de psychiatrie (1996, révisée en 2011)
- Le Guide normatif « Santé mentale, droits humains et législation : orientations et pratiques » de l’OMS et du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH, 2023)
- Autres : Les Directives du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour le soutien en santé mentale et psychosocial dans les contextes humanitaires ; L’Observation générale n° 5 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur « Les personnes souffrant d’un handicap » (1994) et l’observation générale n° 14 sur « Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint » (article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 2000)
De plus, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (CDH) publie régulièrement des rapports et adopte des résolutions afin d’intégrer une perspective des droits humains dans la santé mentale, en mettant l’accent sur l’égalité devant la loi et l’interdiction absolue des traitements forcés et de la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux. Parmi les documents les plus significatifs figurent le rapport sur la santé mentale et les droits de l’homme de cette année (A/HRC/58/38), ainsi que la résolution A/HRC/RES/32/18 (2016), la résolution A/HRC/RES/36/13 (2017) et la résolution A/HRC/RES/43/13 (2019).
Enfin, cette réflexion sur la santé mentale s’étend désormais au droit international humanitaire (DIH), transformant progressivement les approches des praticiens de cette lex specialis. Si les personnes souffrant de CMD ne bénéficient pas d’une protection explicite dans les situations de conflit armé en vertu du DIH, une évolution remarquable s’observe. En décembre 2019, la 33e Conférence internationale du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a franchi une étape décisive en adoptant une résolution dédiée aux besoins de santé mentale et de soutien psychosocial des personnes affectées par les conflits armés, les catastrophes naturelles et autres situations d’urgence. Cette approche reconnaît que « le droit en matière de santé mentale implique une relation complexe entre l’État, la communauté et l’individu, avec un équilibre délicat entre mesures de protection et respect des droits humains (…) le droit international humanitaire exige dès lors la non-discrimination et le respect de tous les droits dans la mise en œuvre du droit à la santé, notamment à travers des politiques, programmes, plans et services de santé adaptés ».
« Il y a un droit en vertu duquel nous pouvons ôter la vie à un homme, mais aucun qui permette de lui ôter la mort » – F. Nietzsche
Cette analyse des instruments normatifs me permet d’ouvrir maintenant la voie à l’examen de la situation concrète de ceux qui, confrontés à leurs troubles mentaux, souhaitent mettre fin à leurs jours et revendiquent par conséquent un « droit au suicide ». ll est apparu, au fil de mes recherches, que la réflexion sur un « droit de mourir » et la protection de ceux souhaitant y recourir, constituait une préoccupation récurrente et bénéficiait d’une attention particulière en droit international. Faisant l’objet d’une bibliographie académique qui ne cesse de se densifier, le droit de mourir constitue une question contemporaine majeure à l’aune de la légalisation de procédures comme l’euthanasie et le suicide médicalement assisté. Deux camps se dessinent alors : d’un côté, les pays européens comme le Benelux, l’Espagne et le Portugal, qui ont franchi le pas de la légalisation de l’euthanasie active ; de l’autre, les vingt-cinq États qui n’ont toujours pas décriminalisé le suicide. Or, pour certains, la criminalisation du suicide constitue une forme de discrimination à l’égard des personnes souffrant de troubles mentaux et compromet la mise en œuvre d’une politique internationale de santé mentale respectueuse des droits humains. De cet antagonisme naît naturellement un débat où trois articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme font figure de références cardinales, à savoir l’article 3 (le droit à la vie), l’article 5 (prohibant la torture ainsi que les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) et l’article 12 (le droit à la vie privée).
En effet, la logique veut qu’en jouissant du droit à la vie, il est antinomique de prétendre à un droit de mourir qui annule par essence la substance et la valeur du premier. « Le concept même du droit de mettre fin à sa vie semble contraire à un principe fondamental du droit international relatif aux droits de l’homme : la valeur intrinsèque de la vie humaine. » Néanmoins, cette objection liminaire — si légitime soit-elle — se heurte à une conception concurrente, celle du « droit de mourir dans la dignité » lequel « relève du champ d’application général des valeurs fondamentales reconnues par plusieurs droits de l’homme, notamment l’intérêt humain pour l’autonomie et la vie privée. » L’interaction complexe entre ces trois droits (articles 3, 5, 12) universellement garantis génère donc une tension quant à leur cohabitation, puisque si l’argument selon lequel le suicide représente un déni direct du droit à la vie peut être considéré comme valide, l’argument justifiant son interdiction ou sa criminalisation s’avère tout aussi délétère à la protection des droits à la vie privée et à une vie digne (i.e. protection de notre pouvoir décisionnel sur la valeur de notre vie, la manière de la vivre et la façon de la conclure).
Cela dit, même si « le suicide est un problème majeur de santé publique à l’échelle mondiale » et suscite nombre de réflexions légales, « il est rarement considéré comme une question relevant des droits humains », et seule « la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a pris position de manière ferme sur l’existence d’un droit humain au suicide ». En effet, la CEDH s’est penchée sur le droit au suicide assisté (PAS) et à l’euthanasie dans le cadre de plusieurs affaires différentes. Dans l’affaire Pretty c. Royaume-Uni (2002), la CEDH considère que « l’on ne peut exclure que le fait d’empêcher la requérante d’exercer son choix d’éviter ce qui, à ses yeux, constituera une fin de vie indigne et pénible représente une atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée. » En effet, « la faculté pour chacun de mener sa vie comme il l’entend peut également inclure la possibilité de s’adonner à des activités perçues comme étant d’une nature physiquement ou moralement dommageable ou dangereuse pour sa personne (…), la jurisprudence des organes de la Convention considère l’imposition par l’Etat de mesures contraignantes ou à caractère pénal comme attentatoires à la vie privée. » Dans une formulation réservée (Petty c. Royaume-Uni, supra, pr 41.), « la Cour a observé une différence entre un individu ayant un droit fondamental à mourir et les États ayant une obligation positive fondamentale d’empêcher une personne de mettre fin à ses jours. » En outre, dans l’affaire Haas c. Suisse (2011), la CEDH « estime que le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de former librement sa volonté à ce propos et d’agir en conséquence est l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention » (§ 51). La CEDH reconnaît donc le droit de mourir comme un aspect du droit au respect de la vie privée en vertu de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais rejette l’argument de « l’existence d’une obligation positive des États d’avoir à mettre en œuvre des mesures propres à faciliter la commission de tels suicides. » Pour consulter la jurisprudence de la CEDH en vertu des articles 3, 5 et 8 de la Convention et relative à la santé mentale, je vous redirige vers le Rapport « Rights of persons in relation to involuntary placement and treatment in mental healthcare facilities » (2023) et le factsheet « End of life and the European Convention on Human Rights.»
Au-delà de ces observations, ce qu’il faut retenir est que « la question pertinente n’est pas de savoir si une autorité en matière de droits de l’homme peut déclarer ex nihilo un droit au suicide. La question est de savoir si un tel droit doit être déduit des principes qui sous-tendent le droit international des droits de l’homme et doit s’inscrire dans le champ d’application d’un ou plusieurs droits de l’homme protégés par un traité.»
Conclusion
« De ‘lunatiques’ à ‘fous’, puis ‘retardés mentaux’, ‘malades mentaux’ et enfin ‘personnes atteintes de troubles mentaux’, la terminologie reflète l’évolution des attitudes envers la santé mentale et, indirectement, une sensibilité accrue aux questions relatives aux droits humains. Elle fait écho à l’évolution de la perception, qui est passée de ‘dérangés’ à ‘victimes’, puis à ‘personnes ayant des droits‘ ». Peut-on dès lors conclure que Yelena disposait de la possibilité de se tourner vers le droit international pour affronter son mal-être ou revendiquer un droit au suicide ? À la première interrogation, ma réponse est résolument positive, eu égard à l’intérêt manifeste que portent désormais les institutions internationales à la protection des personnes souffrant de troubles mentaux et à la reconnaissance de leurs droits fondamentaux. Néanmoins, il ne s’agit là que des prémices d’une démarche encore inachevée, marquée par deux lacunes majeures dans cette « human rights-based approach » en matière de santé mentale : d’une part, la « jurisprudence internationale demeure insuffisamment développée pour orienter la gouvernance en matière de santé mentale » ; d’autre part, « les troubles mentaux ne sont pas considérés comme une priorité dans le cadre de l’aide humanitaire ou des activités de développement. » Mais face à ces défis des solutions se présentent, comme l’élaboration d’un protocole additionnel à la CDPH ou la redéfinition des principes non contraignants de l’ONU et de l’OMS pour les adapter aux situations des conflits armés. À la deuxième interrogation, Yelena aurait pu revendiquer un droit au suicide — ce qui constitue déjà un accomplissement majeur des sociétés démocratiques contemporaines —, mais elle se serait heurtée à la sagesse prudentielle de la CEDH dans l’octroi de ce droit. Avoir le droit de mourir dignement, en raison d’une souffrance physique ou mentale, devrait être envisagé au cas par cas plutôt que d’adopter un caractère universel, tant les dérives potentielles sont nombreuses en l’absence d’un système de régulation internationale. Il n’en demeure pas moins que le droit international a effectivement osée franchir les frontières de l’intime, libérant ainsi la parole sur des sujets longtemps indicibles.
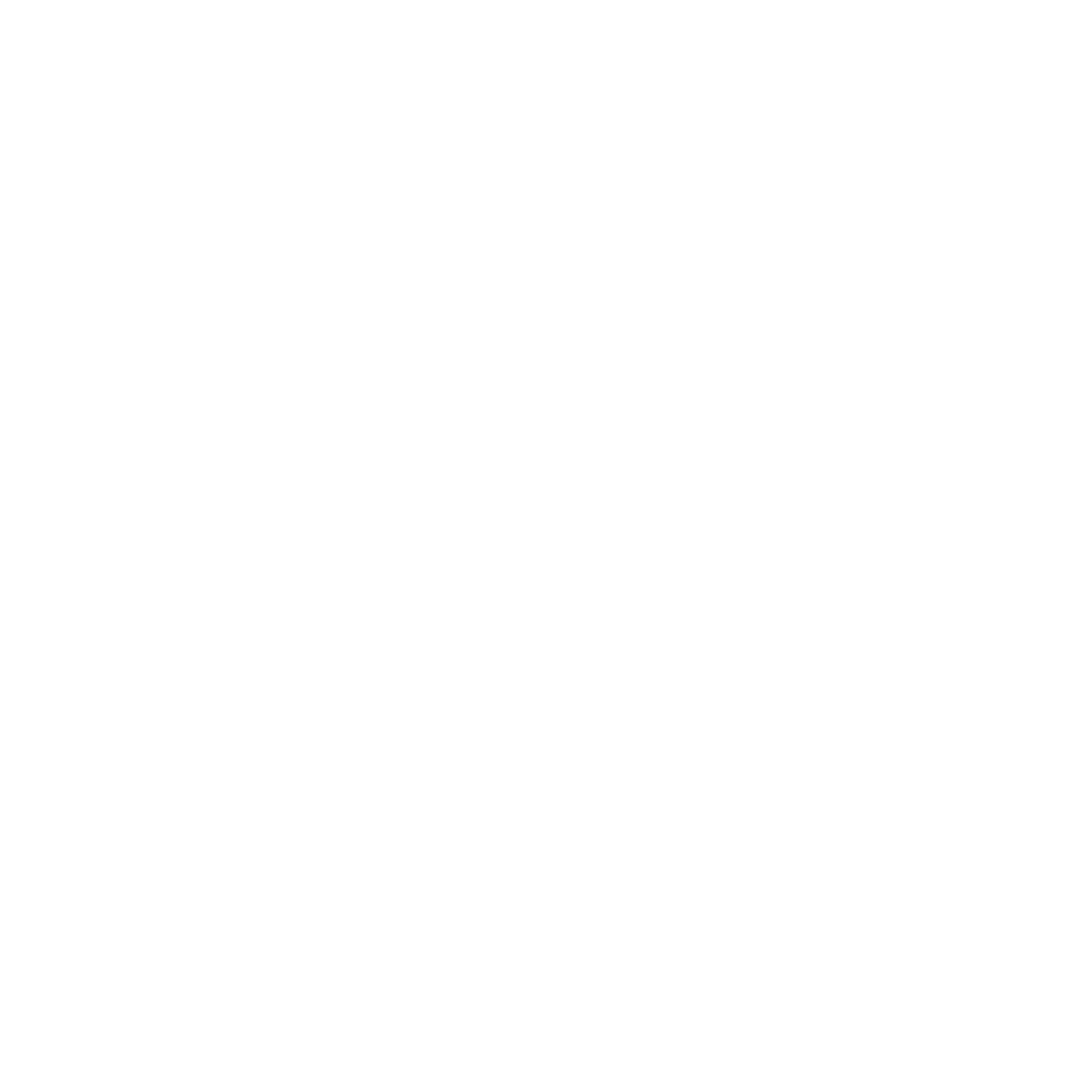
Répondre à inventive4dd076f464 Annuler la réponse.